
Au début de l’année 1981, le compositeur parisien Dominique Probst et le célèbre dramaturge Eugène Ionesco entamèrent une étroite collaboration en vue de la création d’une œuvre lyrique pour le théâtre. L’opéra, commandé par Bernard Lefort, alors directeur général du Théâtre national de l’Opéra de Paris, fut Maximilien Kolbe, en mémoire de la vraie figure historique du prêtre polonais mort dans le camp d’Auschwitz durant l’été 1941. Tout d’abord, donc, un opéra sur Auschwitz, Maximilien Kolbe dramatisant essentiellement les quinze derniers jours de vie du prêtre, lorsqu’il se trouvait déjà dans le camp. Mais aussi, secondairement, un opéra à caractère manifestement religieux et catholique, l’histoire de Père Kolbe – sur laquelle nous aurons également l’occasion de revenir dans les pages à suivre – étant d’ailleurs celle d’un martyr, béatifié en 1971 par le Vatican et canonisé ensuite, en 1982. Sous la direction du polonais Tadeusz Bradecki, l’opéra fut représenté pour la première fois en 1988 seulement, à Rimini (Italie), à l’occasion du Meeting annuale di Comunione e Liberazione. Tandis que l’année suivante, pour la première française de l’opéra, les 7 et 8 octobre 1989, Ionesco et Probst – et Bradecki, le metteur en scène – optèrent même pour une mise en scène dans la Cathédrale d’Arras (Hauts-de-France).
Un opéra et, qui plus est, un opéra sur Auschwitz, dans un lieu aussi sacré qu’une cathédrale. Pourquoi ce choix ? Pourquoi une cathédrale et non, tout simplement, un théâtre ? Relue rétrospectivement, l’idée n’est pas si étrange qu’elle pourrait de prime abord paraître, compte tenu de l’histoire retracée par les deux artistes dans leur opéra : l’histoire d’un martyre, d’un sacrifice. Une première hypothèse, dès lors, ici s’impose : Maximilien Kolbe dans une cathédrale, à la manière d’un chant liturgique, un « exemplum catholique »1, une prière, afin d’essayer de surdéterminer symboliquement l’histoire de Père Kolbe. Néanmoins, en décrivant en détail une grande partie des opérations scénographiques réalisées par Bradecki pour mettre en relief, ou bien pour cacher certains motifs iconographiques de la Cathédrale d’Arras, nous verrons plus en général de quelle manière le metteur en scène a su réaménager l’espace interne de la Cathédrale afin de l’adapter parfaitement aux contenus thématiques de l’opéra.
Dans un premier temps, après avoir esquissé une genèse rapide de l’opéra, nous focaliserons donc notre attention autour du dispositif scénique imaginé par Bradecki : nous expliquerons, en d’autres termes, comment il a réussi à réinventer théâtralement l’espace de la Cathédrale, mais sans toutefois jamais le profaner. Ensuite, dans la seconde partie de cette étude, nous analyserons de plus près les enjeux majeurs (symboliques, esthétiques, culturels, etc.) sous-tendant la création de cette mise en scène d’Arras. Nous repartirons de cette affirmation de M. Henri Derouet2, alors évêque du diocèse d’Arras, ayant estimé qu’il n’y aurait pas de meilleur endroit que la Cathédrale d’Arras pour ce « moderne "mystère" d’Auschwitz »3 qu’est Maximilien Kolbe. De même, comme le précisait un article publié quelques jours avant le spectacle dans Église d’Arras, la revue officielle du diocèse, « lors de la reconnaissance des lieux à la Cathédrale, Dominique Probst a parlé de l’adéquation du lieu pour son opéra »4. Or, qu’est-ce qui aurait fait de la cathédrale, et notamment de la Cathédrale d’Arras, un lieu idéal pour la mise en scène de l’opéra ? Dans quel sens fallait-il comprendre les propos de M. Derouet et de Probst lui-même ? Voilà le type de questions, dont nous venons de fournir un cadre assez général, auxquelles nous essaierons de répondre dans la seconde partie de cette étude.
Pour mieux comprendre pourquoi l’œuvre d’Ionesco et Probst a été mise en scène dans à la Cathédrale d’Arras, il convient d’abord de partager quelques détails sur sa genèse.
Ainsi que nous venons de le mentionner au préalable, la première rencontre entre Ionesco et Probst remonte au début de l’année 1981. L’année précédente, Bernard Lefort, à l’époque administrateur général du Théâtre National de l’Opéra de Paris, avait commandé à Probst une œuvre lyrique à thème religieux. Pour le sujet – c’est d’ailleurs Probst lui-même qui a par la suite raconté la genèse du projet dans un article publié en 1994 –, le compositeur parisien pensa immédiatement à l’histoire et au martyre de Maximilien Kolbe, une histoire qui lui avait été racontée lorsqu’il était encore enfant par son père :
Comme je cherchais un sujet à traiter, une histoire que mon père m’avait racontée lorsque j’étais enfant me revint alors subitement à l’esprit : celle de Maximilien Kolbe, franciscain polonais déporté au camp d’Auschwitz qui, en août 1941, offrit volontairement sa vie pour sauver celle d’un père de famille condamné à mourir de soif et de faim avec neuf autres otages à la suite de l’évasion d’un prisonnier5.
L’histoire de Maximilien Kolbe, retracée ici à grandes lignes par Probst, était la suivante6.
1941, fin juillet, nous sommes à Auschwitz. Père Kolbe s’y trouve depuis mai, après avoir été arrêté par la Gestapo en février et emprisonné initialement dans une prison à Varsovie. Pendant les travaux forcés, un prisonnier réussit momentanément à s’évader. Les SS, dès qu’ils s’aperçoivent de l’évasion, quelques heures plus tard, décident en guise de représailles d’envoyer dix prisonniers au Bunker – une sorte de cage souterraine de 5m2 de superficie –, condamnés à y mourir de froid (ils sont nus) ainsi que de faim et de soif. Le choix des prisonniers à envoyer au Bunker est aléatoire et il se porte entre autres, parmi tous les déportés rassemblés sur la Appellplatz, sur un sergent polonais, Franciszek Gajowniczek, lequel, à l’écoute de son nom, commence à sangloter et à implorer pitié pour sa vie : il est marié et père de deux enfants. C’est alors que, sortant du rang, Père Kolbe prend la parole pour demander aux SS, et notamment au commandant du camp, de prendre la place de cet homme. Le commandant, stupéfait par le propos du déporté, néanmoins accepte, ordonnant en même temps à Gajowniczek de reprendre sa position, dans les rangs. Père Kolbe, avec neuf autres prisonniers, rejoint peu après le Bunker. Dans cette cage de 5m2 de superficie, Père Kolbe résistera quinze jours. Au bout de ces quinze jours, il sera achevé par une piqûre de phénol, ordonnée par le commandant du camp lui-même.
Voici l’histoire à thème religieux choisie par Probst : Maximilien Kolbe et son martyre – que le Vatican reconnut officiellement en 1971 (Béatification) et en 1982 (Canonisation). Mais Probst n’étant que compositeur, cela impliquait un librettiste sensibilisé par un tel propos. Probst – c’est toujours lui qui raconte dans son article de 1994 – s’adressa ainsi au Révérend Père Carré de l’Académie Française, ami de sa famille, qui lui proposa à son tour de rencontrer Ionesco, dont il connaissait la fascination toute particulière à l’égard de la figure de Kolbe7. Ionesco, passionné par l’idée d’écrire pour la première fois de sa carrière de dramaturge un texte destiné à l’opéra, accepta aussitôt. Si bien que les deux entreprirent tout de suite une collaboration qui les porta, début 1982, à la création d’une œuvre lyrique ne comptant initialement que deux actes. Deux actes, en résumé, pour deux scènes temporellement séparées de quinze jours : le premier, allant de l’évasion du prisonnier du camp jusqu’à l’avancée de Maximilien Kolbe devant le commandant ; et le second, en revanche, se concentrant essentiellement sur les derniers instants de vie du prêtre polonais dans le Bunker – quinze jours plus tard.
Ainsi, en 1982, l’opéra était prêt. Mais paradoxalement, c’est à ce moment-là que les problèmes commencèrent. L’Opéra de Paris, d’une part, honora la commande pour l’œuvre ; mais, d’autre part, pour des raisons de changement d’administrateurs, il ne fut pas donné suite au projet du spectacle. Soudain, Ionesco et Probst se retrouvèrent sans un théâtre où représenter leur opéra. Pendant quelques années, les deux artistes, dans l’attente d’un nouveau contrat, mirent le projet de côté. Ils eurent toutefois raison de ne pas l’abandonner complètement. En effet, 1987 fut l’année décisive : Mario Guaraldi, l’un des conseillers artistiques du Meeting annuale di Comunione e Liberazione, proposa à Ionesco et à Probst de mettre leur œuvre en scène l’été suivant à Rimini. Les deux acceptèrent, et Ionesco, sur le conseil de Probst et de Guaraldi lui-même, choisit de reprendre le texte du livret et d’insérer un nouvel acte – c’est-à-dire, le deuxième acte de la version finale du livret, dramatisant les premiers moments du personnage de Maximilien Kolbe et des neuf autres prisonniers dans le Bunker.
Le 20 août 1988 à Rimini, après six ans d’attente l’opéra fut présenté pour la première fois, dans un auditorium aménagé pour l’occasion en salle de théâtre. Le spectacle, vu par un public de plus de sept mille personnes, fut un succès, grâce notamment aux choix du polonais Tadeusz Bradecki relatifs à la mise en scène – et sur lesquels nous reviendrons ultérieurement. Mais ce n’était pas fini. Parmi les spectateurs, à Rimini, se trouvait Pierre Host, alors Délégué régional à la Musique et à la Danse au Ministère de la Culture français. Enthousiasmé par le succès du spectacle, il invita Ionesco, Probst et Bradecki à produire leur opéra dans la Cathédrale d’Arras l’année suivante, dans le cadre cette fois-ci d’un ensemble de manifestations commémoratives liées au « Bicentenaire de la Déclaration des Droits de l’homme ».
Trois choses sont ici importantes à retenir :
1) Il est sans doute curieux que les deux premières représentations de Maximilien Kolbe n’aient pas eu lieu dans un véritable théâtre, mais dans deux lieux aménagés pour l’occasion en salles de théâtre : un auditorium, à Rimini, et la Cathédrale, à Arras.
2) À Arras, de même qu’à Rimini, l’opéra fut représenté dans le cadre de deux manifestations culturelles bien précises et chacune d’une durée de plusieurs jours : à Rimini, tout d’abord, lors des journées du Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, un Meeting annuel organisé par le mouvement catholique italien Comunione e Liberazione ; et à Arras, ensuite, lors d’une série de manifestations culturelles en l’occasion du « Bicentenaire de la Déclaration des Droits de l’homme » et organisées par le Ministère de la Culture français, en accord avec la mairie et le diocèse d’Arras.
3) Lorsque Probst et Ionesco commencèrent leur collaboration en 1981, tous deux imaginaient leur opéra tel une représentation classique, dans un théâtre. L’idée de représenter l’opéra hors d’un théâtre et de plus dans une cathédrale, n’était encore aucunement envisagée par les deux artistes en 1981.
C’est donc pourquoi, une figure centrale dans le contexte
des premières représentations de l’opéra fut celle de Tadeusz Bradecki, le
metteur en scène à l’origine des spectacles de Rimini et d’Arras. Pour lui, en
comparaison à Ionesco (librettiste) et Probst (compositeur), le défi était de
nature esthétique et relevait
fondamentalement de deux problématiques majeures. Premièrement, celle de définir
la manière avec laquelle porter sur scène l’horreur d’Auschwitz : garder
une certaine approche réaliste ou opter plutôt pour une mise en scène plus
essentielle et minimaliste ? Dans ses « Notes du metteur en
scène » – successivement incluses dans le livret de l’opéra distribué
au public à Rimini –, Bradecki lui-même écrivait :
Comment montrer Auschwitz sur scène ? Imiter les montagnes de vieilles chaussures, faire porter aux figurants l’habit rayé et feindre un martyrologe ? Dans le cas présent du camp de concentration, la fiction et l’imitation, tendances premières du théâtre, montrent brutalement toute la grossièreté artificielle de la convention.
Kolbe et ses neuf camarades moururent au bout de deux semaines passées dans un bunker en ciment de 5 mètres carrés de superficie.
Cela a-t-il un sens de montrer sur scène un tel fait ? Comment « jouer » l’agonie des dix hommes au milieu de leurs excréments ? Peut-il y avoir des versions plus ou moins « scéniques » d’une telle situation ?8
D’autre part, à Rimini et à Arras, l’autre grand défi auquel Bradecki se trouvait confronté était celui de transformer deux espaces initialement non théâtraux, tels qu’une salle de conférence (Rimini) et une Cathédrale (Arras), en véritables lieux de théâtre. Pour résumer : comment aménager ces deux espaces, pour qu’ils puissent, de fait, accueillir au sein de leur périmètre une œuvre lyrique – c’est-à-dire, une œuvre impliquant une scène et une place pour l’orchestre ? Par ailleurs, Maximilien Kolbe étant une œuvre dramatique se déroulant à Auschwitz : à quel dispositif scénique avoir recours pour représenter un camp de concentration dans deux espaces si particuliers ?
Nous comprenons qu’il est ici fondamental d’apporter quelques informations sur le modus operandi de Bradecki à Rimini. Cela nous permettra ainsi de donner un sens plus concret à certaines variations scéniques que le metteur en scène polonais introduisit plus tard à Arras, pour la mise en scène dans la Cathédrale.
Or, dans l’auditorium de Rimini – ainsi que nous pouvons le voir sur la photographie de la maquette de la scénographie, figurant dans les « Notes du metteur en scène » du livret de Rimini [Fig. 1, 2] –, Bradecki réinventa l’horizontalité de l’espace théâtral classique, c’est-à-dire l’horizontalité du plateau théâtral commun (le plateau d’une salle de conférence), en le prolongeant par deux avancées de scène. En ce qui concerne la première, il s’agissait d’une avancée de scène en forme de croix. La forme, très symbolique, rappelait notamment la structure d’une église, avec un petit autel en son centre : c’était sur cet autel, non par hasard, que Maximilien Kolbe mourrait, à la fin du troisième acte. Alors qu’une seconde avancée de scène, cette fois-ci de forme rectangulaire, était quant à elle attribuée à l’orchestre.

[Fig. 1]
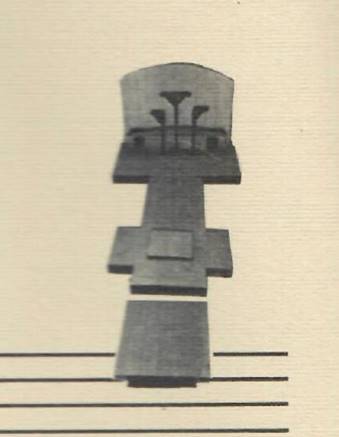
[Fig. 2]
Par ailleurs, tout au fond de la scène, le plateau principal portait sur trois gibets : trois gibets qui renvoyaient évidemment, toujours dans une logique symbolique, au Calvaire. Fait curieux à ce propos : dans son livret, Ionesco parlait d’un seul gibet et, en particulier, d’un gibet qu’il fallait à peine apercevoir et disposé au fond de la scène : « On aperçoit aussi un gibet »9, écrivait-il. Mais Bradecki, dans ce spectacle de Rimini, en installa deux supplémentaires, bien visibles – nous pouvons le constater sur cette photographie prise lors du spectacle [Fig. 3] –, de manière à thématiser davantage le parallèle entre l’histoire, sur scène, du sacrifice de Maximilien Kolbe et celle du Calvaire de Jésus-Christ.

[Fig. 3]
Dès lors, l’expérience de Bradecki à Rimini pourrait se résumer en ces termes : l’auditorium, en tant que lieu de départ essentiellement profane, nécessitait selon le metteur en scène, une intervention scénographique susceptible de surdéterminer symboliquement l’espace où les acteurs jouaient, conformément à la nature religieuse de l’opéra en question. Ainsi, le résultat obtenu était une scénographie que l’on pourrait définir encore figurative, bien que très minimaliste et sombre. En d’autres termes, pour Bradecki, à Rimini, il était question de dissimuler autant que possible l’atmosphère et la nature clairement profanes du lieu (l’auditorium) de la mise en scène, et le recours à des motifs scénographiques religieux (le plateau en forme de croix, un autel, les trois gibets) avait donc pour objectif de créer une atmosphère et un esprit sacrés.
Et maintenant, après avoir introduit au modus operandi de Bradecki à Rimini, passons à sa mise en scène dans la Cathédrale d’Arras.
À l’évidence, de Rimini à Arras, le point de départ n’était pas le même. A Rimini, en effet, Bradecki devait recréer une atmosphère sacrée dans un espace à l’origine profane. En revanche, à Arras, le défi était l’inverse : il se trouvait dans une cathédrale, un lieu où les éléments iconographiques et architecturaux de dimension sacrée étaient déjà omniprésents. Ainsi, pour épargner le spectacle d’une redondance symbolique trop marquée, il lui fallait cette fois-ci trouver des stratagèmes esthétiques afin de dissimuler cet excès d’iconographie religieuse. Comment faire ?
Tout d’abord, commençons par dire de quelle manière Bradecki disposa la platée. Pour l’occasion, il remplaça toutes les chaises présentes dans la nef centrale par des gradins, allant de l’entrée de la Cathédrale jusqu’au niveau du transept. Ainsi que Marguerite Jean-Blain le suggérait dans sa description du spectacle, quelques spectateurs étaient probablement aussi installés dans une tribune située au-dessus de l’entrée de la Cathédrale : là où autrefois il y avait un orgue10. Gradins et tribune : même si le spectateur se trouvait dans une cathédrale, il ne regardait plus la scène/plateau (à savoir, l’autel) depuis le bas, mais plutôt depuis le haut, avec ce que l’on pourrait qualifier de regard panoramique [Fig. 4]. Ce détail n’est en effet pas sans importance, car cette seule disposition de la platée représentait déjà un thème esthétique, une prise de position : de ce fait, en éloignant verticalement le public du plateau, Bradecki favorisait une participation moins emphatique de la part du spectateur et davantage analytique (dans le sens, précisément, de panoramique) vis-à-vis de la scène (dramatique).

[Fig. 4]
Mais ensuite – ce qui est évident –, c’est surtout au niveau de la scène et du décor que Bradecki intervint le plus significativement. L’espace scénique, couvrant à peu près une surface allant de la grille de communion jusqu’à la moitié du chœur de la Cathédrale, fut lui aussi légèrement surélevé – de même que la platée –, et une draperie sombre cachait le maître-autel sur le podium. Ainsi que nous pouvons le voir sur cette photographie de la Cathédrale vue depuis l’entrée et un photogramme du spectacle enregistré en 1989, l’aniconisme était le modèle esthétique qui l’emportait [Fig. 5, 6]. Toute iconographie ou objet religieux présent habituellement sur le podium de la Cathédrale d’Arras (maître-autel, ambon, orgue) fut soit déplacé, soit couvert, et ce jusqu’à créer une surface plane et nue. Compte tenu des dimensions du transept, l’espace destiné au jeu des acteurs était immense, particulièrement en profondeur. Aussi, cet espace était parfaitement visible au public, qui était – comme nous l’avons déjà précisé – assis sur des gradins.

[Fig. 5]

[Fig. 6]
Par ailleurs, les trois gibets situés au fond de la scène à l’occasion de la représentation de Rimini, eux aussi, disparurent. À leur place, nous trouvions au contraire un grand rideau noir, qui masquait tout le fond du chœur ainsi que le déambulatoire, et qui se prolongeait jusqu’à couvrir entièrement les côtés gauche et droit de l’espace scénique, en donnant ainsi l’impression d’enfermer ce dernier comme dans une sorte de cage. Il s’agissait là d’un espace-Bunker, d’autant plus sombre que l’énorme rideau noir hissé le long de ses trois flancs empêchait la lumière extérieure – c’est-à-dire la lumière provenant de grands vitraux situés à l’arrière – d’illuminer la scène. Dès lors, l’effet était sublime : le public, positionné ainsi sur des gradins surélevés par rapport au niveau de l’espace scénique, regardait une scène qui était certes encagée horizontalement, mais qui s’ouvrait verticalement, en raison des voûtes de la Cathédrale d’une hauteur de 30 mètres.
À Arras, l’aniconisme, c’est-à-dire le choix de prévoir une scène vide d’images et d’icônes religieuses, devint pour Bradecki l’option esthétique préférable. Le metteur en scène était bien conscient, en opérant dans un cadre aussi somptueux et sacré qu’est l’espace d’une cathédrale, que le lieu en lui-même véhiculait déjà la thématique religieuse et métaphysique de manière suffisante, par rapport à l’auditorium de Rimini. Et ce, par conséquent, à tel point que mettre en relief l’iconographie religieuse déjà présente dans la Cathédrale (ambon, maître-autel, etc.) aurait, par bien des aspects, été une opération plus que redondante, étant donné la dimension suffisamment agiographique du livret d’Ionesco.
Le dispositif scénique élaboré à Arras par Bradecki ainsi décrit, le moment est venu de reprendre les mots prononcés à la veille du spectacle par Probst lui-même et par M. Derouet, alors évêque du diocèse, qui décrivaient la Cathédrale d’Arras comme un lieu idéal pour la mise en scène de ce « moderne "mystère" d’Auschwitz » qu’est Maximilien Kolbe. La thèse est certainement très suggestive et, dans l’ensemble, également partagée par les critiques de l’époque : au lendemain des deux premières françaises du spectacle dans la Cathédrale, les 7 et 8 octobre, les critiques s’avérèrent d’ailleurs pour la plupart positives. De plus, pas un seul mot ne fut écrit au sujet d’une éventuelle inadéquation du lieu de représentation11. Ceci dit, il reste néanmoins essentiel d’approfondir la thèse de Probst et M. Derouet, ne serait-ce que pour mieux comprendre les enjeux majeurs (symboliques, esthétiques et culturels) faisant de la Cathédrale d’Arras le lieu idéal pour la mise en scène artistique d’Auschwitz.
Cathédrale et Auschwitz : tout, du reste, laisserait à penser le contraire. En effet, confrontons maintenant Maximilien Kolbe à la célèbre pièce de T. S. Eliot, Meurtre dans la cathédrale (1935), elle-même mise en scène à plusieurs reprises – et encore aujourd’hui – dans des cathédrales et des églises12. Cette pièce, qui dramatisait le meurtre de l’archevêque Thomas Becket dans la Cathédrale de Canterbury en 1170, justifiait une mise en scène dans un lieu sacré. Dans ce cas de figure, la cathédrale était non seulement un motif thématique, mais aussi scénique. Et ce, de sorte que mettre en scène ce drame dans une cathédrale répondait – et répondrait encore aujourd’hui – à un choix de représenter l’évènement de manière réaliste, à l’endroit où il s’est produit. Mais avec Auschwitz, au contraire ? À première vue, aucun enjeu mémoriel, historique ou thématique ne semblerait rattacher un lieu sacré tel qu’une cathédrale aux persécutions perpétrées par les nazis. Comme nous le savons, l’extermination avait ses propres lieux, parmi lesquels on retrouve les ghettos, les camps de concentration et d’extermination, mais pas forcément les églises ou les cathédrales. Dès lors, selon quelle logique évoquer la cathédrale, en particulier la Cathédrale d’Arras, comme un lieu idéal pour la mise en scène d’un opéra sur Auschwitz – ainsi que M. Derouet et Probst l’ont fait ?
Plusieurs questions commencent à se croiser ici : 1. Pourquoi la cathédrale ? ; 2. Comment représenter Auschwitz sur scène ? Pour y répondre, nous procéderons en deux étapes. Premièrement, nous essaierons de faire un bilan général visant à définir les enjeux culturels majeurs liés à l’imaginaire contemporain de la Cathédrale d’Arras : en d’autres termes, nous tenterons d’illustrer les principales raisons qui ont poussé le diocèse d’Arras, ainsi que les trois artistes (Ionesco, Probst et Bradecki) à accepter le conseil de Pierre Host envisageant de porter le spectacle de Rimini dans la Cathédrale. Alors que, dans un second temps, en nous focalisant sur le seul art théâtral, nous tenterons de comprendre comment le style artistique de Bradecki a influencé le résultat final de la mise en scène – et ce, au-delà même des contenus thématiques du livret de Ionesco.
Avant toute chose, il faut commencer par faire une distinction nette entre ce qu’une telle représentation aurait pu signifier pour le diocèse d’Arras et, d’autre part, pour des hommes de théâtre comme Ionesco, Probst et Bradecki. D’ailleurs, il est évident que pour M. Derouet, en tant qu’évêque d’Arras, les objectifs sous-tendant ce projet de mise en scène dans sa Cathédrale ne pouvaient pas être les mêmes que ceux poursuivis par les trois artistes, répondant quant à eux, à des logiques liées davantage à l’esthétique et à la dramaturgie.
Concernant ce que la possibilité de représenter Maximilien Kolbe dans la Cathédrale d’Arras pouvait signifier pour le diocèse, il y aurait au moins deux considérations majeures à introduire dans la réflexion.
La première relèverait d’un détail historique, lié notamment au fait que les cathédrales et les églises – y compris la Cathédrale d’Arras – auraient souvent servi de salles de théâtre par le passé. À titre d’exemple : du Moyen Âge jusqu’au début de la Renaissance, il n’était pas rare pour les églises et les cathédrales d’accueillir divers types de représentations artistiques à caractère religieux. La plupart du temps, ce genre de spectacles avaient lieu dans la cour des églises ou des cathédrales, à proximité de ces dernières. Mais ces représentations, parfois, avaient également lieu à l’intérieur même des lieux sacrés – de la même manière que Maximilien Kolbe des siècles plus tard –, ainsi que le démontrent plusieurs témoignages et iconographies picturales de l’époque.
Deux exemples, sûrement parmi les plus célèbres et cités, suffiront à montrer de manière très claire cette parenté entre théâtre et église/cathédrale. Concernant le premier, il faut mentionner la miniature réalisée par Hubert Cailleau en 1577, représentant la Passion de Valenciennes [Fig. 7]. Document historique essentiel, cette miniature nous donne aussi de manière implicite une idée du fonctionnement d’un théâtre de l’époque. Les mansiones, ces espaces/tribunes que nous pouvions trouver à l’intérieur ou dans la cour des églises/cathédrales, étaient en effet les lieux de la prédication et du jeu des acteurs. Ainsi que la miniature de Cailleau le montre clairement, il pouvait y en avoir plusieurs pour un seul et même spectacle. Néanmoins, le fonctionnement était toujours à peu près le même : l’histoire principale se déroulait dans l’une de ces mansiones, tandis que l’on pouvait voir d’autres acteurs jouer simultanément dans les autres.

[Fig. 7]
Pour témoigner de cette affinité entre théâtre/théâtralité et église/cathédrale, la miniature de Cailleau s’avère ainsi être l’un des exemples parmi les plus significatifs. Secondairement, nous pouvons citer le fameux Volo dell’Angelo (Le vol de l’Ange) de l’architecte italien Filippo Brunelleschi, ayant eu lieu en 1439 dans la Chiesa San Felice de Florence, dans le cadre d’une représentation de l’Annonciation. Le dispositif scénique, que nous pouvons voir en action dans la photo montrant une maquette de l’intérieur de l’église de Florence [Fig. 8], était aussi simple qu’innovant13. Pour l’occasion, Brunelleschi avait imaginé un ange suspendu au-dessus des spectateurs, descendant la nef centrale jusqu’à une petite tribune située à proximité de l’entrée de l’église. Après l’Annonce à Marie, l’ange faisait le trajet à rebours, se croisant avec une flamme qui arrivait du sens opposé et qui représentait le Saint-Esprit.

[Fig. 8]
Or, c’est dans le même sillage que celui des mansiones du Moyen Âge et du Vol de l’Ange de Brunelleschi, que le diocèse d’Arras avait consenti au projet de mise en scène de Maximilien Kolbe dans les espaces de la Cathédrale. En prenant cette décision, pour le diocèse d’Arras, il ne s’agissait pas même d’une nouveauté ou d’un unicum, mais plutôt d’un retour au passé et à la tradition. Autrement dit, un retour à une époque où c’était la communauté ecclésiastique elle-même qui mettait ses espaces à disposition pour des spectacles religieux. En écho à cette idée, la revue Église d’Arras présentait, à la veille du spectacle, l’opéra d’Ionesco et Probst en ces termes : « Pour les chrétiens, l’art, la musique, le sacré sont des chemins vers la foi, l’expression d’une forme de prière. Nous pouvons, selon nos sensibilités, être attentifs à d’autres aspects »14. Indirectement, Église d’Arras faisait là un lien avec le passé, en postulant que l’art également pouvait être un vecteur idéal de transmission du message religieux.
D’autre part, il est évident que pour l’Évêché d’Arras, le fait de représenter une œuvre telle que Maximilien Kolbe au sein de la Cathédrale répondait également à des objectifs plus utilitaires, voire idéologiques.
Il est certain que cette représentation donnait la possibilité au diocèse d’Arras d’ouvrir la Cathédrale à un public plus vaste, plus hétérogène, et non uniquement circonscrit, comme d’habitude, aux seuls fidèles ou religieux. L’ampleur de l’événement, organisé par la municipalité d’Arras ainsi que par la direction générale des Affaires Culturelles induisait cette diversité. La résonance médiatique qu’un tel événement était très susceptible d’impliquer n’était pas à sous-estimer. Dès lors, nous comprenons que pour le diocèse d’Arras, accueillir le spectacle dans ses espaces pouvait s’avérer être une occasion unique et idéale pour placer la Cathédrale au centre des intérêts de la citoyenneté toute entière et en réactualiser son image au sein de la quotidienneté arrageoise, reconfirmant ainsi son statut de lieu-symbole de la ville.
Ensuite, il ne faut pas oublier le contexte historique dans lequel le projet tout entier avait été conçu. Le thème de l’opéra – comme nous l’avons souligné –, était un thème essentiellement religieux : c’était là, du reste, la raison majeure pour laquelle, pour le diocèse d’Arras, il pouvait être joué dans la Cathédrale. Mais l’histoire de Maximilien Kolbe n’était pas seulement l’histoire d’un prêtre mort en martyre à Auschwitz. À la fin des années 80 – à savoir, les années des révoltes organisées par le mouvement syndical polonais, Solidarnosc, contre le régime soviétique –, l’histoire de Maximilien Kolbe, relue cette fois-ci avec un ton plus contemporain et allégorique, était avant tout l’histoire d’un homme de foi polonais qui s’opposait à un pouvoir despotique en place. Loin d’être une simple interprétation de notre part, ce sous-texte politique était également reconnu par la même revue Église d’Arras, dans laquelle nous pouvions trouver le texte suivant :
Beaucoup parmi les lecteurs d’« Église d’Arras » ont agi pour la Pologne en envoyant des camions de vivres et de médicaments et sont actuellement sensibles aux demandes d’aides de Walesa à l’Europe pour la libération de son peuple. Certains ont porté le badge de Solidarnosc, d’autres agissent pour la défense des droits de l’homme comme membres d’Amnesty International, de l’ACAT, du CCFD ou de la Ligue des Droits de l’homme.
Au moment où l’on parle beaucoup du Carmel d’Auschwitz, certains iront prier dans le silence au Carmel d’Arras15.
Il n’est pas exclu – nous sommes là dans l’interprétation, faute de disposer de documentation pour le prouver – qu’Host lui-même ait dès le départ pensé porter Maximilien Kolbe dans la Cathédrale d’Arras en raison de cette intention allégorique à laquelle l’œuvre d’Ionesco et Probst se prêtait. Cependant, il est évident que pour le diocèse d’Arras cet élément politique, lié au contexte de l’époque, a joué un rôle de première importance en faveur de la représentation de l’opéra dans la Cathédrale. En définitive, il s’agissait d’une manière idéale pour faire rentrer un motif d’intérêt social et civique (Solidarnosc) dans un contexte également religieux (la Cathédrale), par le détour de l’histoire de Père Kolbe.
Enfin, il faut parler de ce que la Cathédrale d’Arras pouvait représenter pour Ionesco, Probst et Bradecki, les trois artistes impliqués dans la mise en scène.
Là encore, l’idée de monter un spectacle contemporain hors d’un théâtre n’avait en soi rien d’unique, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Le théâtre contemporain – par « contemporain », nous limitons le champ au théâtre d’après la Seconde Guerre Mondiale – a souvent eu recours à ce dispositif scénique, allant par exemple occuper tantôt des usines abandonnées, tantôt des parcs ou d’autres espaces urbains en plein air. Pour rester dans le domaine de la Shoah, l’expérience théâtrale Adam quoi ? (1993) du dramaturge et metteur en scène français Armand Gatti mérite d’être mentionnée. Pour cette pièce, le cadre choisi était la ville de Marseille, qui devenait un circuit, une sorte de lieu-écriture, avec de nombreuses scènes dramatiques distribuées en plusieurs points de la ville : le port, ou encore la cour d’une école juive, pour arriver enfin dans un théâtre, pour la conclusion16.
Il était question, chez Gatti de même que chez tous les autres auteurs étant justement sortis des théâtres, de se soustraire de la rigidité des mises en scène conventionnelles. Souvent regardé comme un art et un lieu élitiste, le théâtre aurait aujourd’hui encore toujours du mal à attirer certains types de publics, tels que par exemple les classes les plus populaires de la société ou bien les jeunes. Si bien que, pour tout auteur, sortir du lieu théâtral en tant que tel, offrirait deux avantages non négligeables. D’une part, cette distanciation du théâtre par rapport à son même lieu de représentation serait un détour formel idéal afin de rapprocher tous les citoyens de cet art. Un détour formel idéal, autrement dit, afin d’élargir davantage son public et entrer davantage dans le quotidien du citoyen – un peu sur le modèle d’Adam quoi ? de Gatti, allant même jusque parmi les dockers du port de Marseille. D’autre part, pour continuer dans le sillage du discours sur la conventionalité du lieu théâtral, imaginer de nouvelles formes de représentations ex situ permettrait par la même occasion d’aller opérer dans des espaces essentiellement vierges – par rapport à la scène théâtrale classique. À savoir, des espaces où il serait possible de reconstruire librement non seulement une scène, mais aussi une platée, expérimentant à la fois de nouveaux espaces d’écoute pour le public.
Or, pour Ionesco, Probst et Bradecki, une cathédrale devait assurément représenter l’un de ces types d’espaces expérimentaux. Nous l’avons vu, d’ailleurs : la disposition du spectateur sur des gradins surélevés par rapport à l’espace scénique, en position uniquement frontale par rapport à ce dernier, suffisait déjà à témoigner de la volonté des trois artistes de repenser le rôle des spectateurs dans le cadre de leur spectacle. Ceci étant dit, en vertu notamment de cette dialectique entre l’élément profane (du théâtre) et l’élément sacré (d’une cathédrale), pour les trois hommes de théâtre, l’idée d’une cathédrale comme lieu de représentation était pertinente pour deux autres raisons spécifiques, intrinsèquement liées au contenu de l’opéra Maximilien Kolbe.
La première concernait moins le livret d’Ionesco et la partition musicale de Probst qu’une particularité scénique et scénographique portant sur la représentation artistique du camp d’Auschwitz.
Force est de constater qu’une quelconque représentation de Maximilien Kolbe, dans un théâtre comme ailleurs, se heurtait inévitablement à plusieurs obstacles esthétiques, relatifs à la difficulté de rendre sur scène l’horreur de l’extermination de manière scéniquement et narrativement vraisemblable. Il s’agit d’une contrainte propre au théâtre, dont les particularités telles que l’immanence et l’immédiateté de la scène font que cet art semble inadapté pour rendre en images la violence et l’atrocité de certains événements historiques – y compris ceux d’un camp d’extermination. Mais avec Auschwitz, au-delà de l’art théâtral en lui-même, le problème est aussi d’ordre ontologique, dans le sens où il concerne la nature fondamentalement « invisible »17 de cet événement. Cette invisibilité, en premier lieu, était celle des cadavres, les victimes d’Auschwitz ayant pour la plupart été réduites en fumée et en cendres dans les fours crématoires : à Auschwitz, en somme, il n’y avait pas de cimetières, desquels exhumer les corps des victimes. Et en ce qui concerne cette même notion d’invisibilité, la documentation visuelle relative aux phases terminales de l’extermination semble manquante également : pas d’images du travail des membres du Sonderkommando18, ni des victimes dans les chambres à gaz19. Ce qui nous ramène directement au cœur du problème auquel Bradecki se trouvait confronté à Rimini et à Arras : quoi montrer d’Auschwitz ? Et encore : comment le faire, dans une dimension soulignant la visée religieuse de l’opéra d’Ionesco et Probst sans tomber dans la redondance ?
Il fallait un détour, qu’il soit thématique ou esthétique. Et c’est là, donc, que la cathédrale entrait en jeu.
À Rimini – comme nous l’avons souligné au préalable –, Bradecki avait dû introduire cette atmosphère sacrée par une scénographie iconophile parce qu’il était dès le départ conscient d’opérer dans un espace essentiellement profane (l’auditorium). À l’inverse, à Arras, il savait que ce travail supplémentaire de reconstruction scénique était tout à fait inutile, du seul fait que la Cathédrale convoquait d’avance tous les motifs sacrés présents dans le livret original d’Ionesco. Or, pour un spectacle religieux sur Auschwitz (Maximilien Kolbe), l’avantage d’une mise en scène dans un lieu de nature symbolique et religieux tel qu’une cathédrale était pour Bradecki plus que considérable. D’abord, en raison de ce cadre particulièrement symbolique et sacré, il était évident que le plus rigoureux des minimalismes scéniques suffirait à invoquer une profondeur spirituelle et métaphysique. Et encore, pour reprendre de plus près le discours sur l’invisibilité d’un événement comme Auschwitz, ce vide scénique, rendu possible par le motif de la cathédrale, libérait ainsi Bradecki de la difficulté de montrer l’extermination sur scène de façon vraisemblable. Paradoxalement, cette dialectique entre le plein (l’acteur en chair et os sur scène) et le vide (la scène vide) se retrouvait à respecter métaphoriquement cette même invisibilité d’Auschwitz dont nous avions parlé au préalable, et ce, bien mieux que ne le ferait tout projet réaliste – entendu comme conforme aux détails historiques.
À ce premier raisonnement illustrant l’idéalité de la Cathédrale selon la perspective des trois artistes, s’ajoute un second, plus proche d’une logique dramatique/dramaturgique que scénique.
Nous avons déjà eu l’occasion de souligner que l’opéra, tel qu’Ionesco l’avait conçu, devait vraisemblablement ressembler à une œuvre-prière. En effet, Maximilien Kolbe l’était non seulement poétiquement – c’est-à-dire métaphoriquement –, mais aussi de facto, par la présence même, dans le livret, de plusieurs moments dramatiques impliquant des prières. À titre d’exemple, citons celle qui apparaît vers la moitié du deuxième acte de l’opéra, au moment où Maximilien, déjà dans le Bunker, déclamait sa profession de foi en direction du public. Mais d’autres prières sont également présentes tout au long du troisième acte. Ainsi, la première était un Requiem en latin chanté par Maximilien, le seul prisonnier du Bunker encore en vie (début du troisième acte), au milieu de ses neuf compagnons morts : « Requiem aeternam dona eis Domine et Lux perpetua luceat eis… »20. Une prière est également livrée à la fin, en guise de conclusion de l’opéra : dans ce dernier cas, il s’agissait d’une Béatitude évangélique chantée en polonais – la langue maternelle de Père Kolbe, venant de mourir sur scène – par un chœur extra-diégétique composé d’un groupe d’enfants :
BLO GOSLAWIENI UBODZY WDUCHU, ALBOWIEM ICH JEST KROLESTWO NIEBIESKIE.
BLO GOSLAWIENI CISI, ALBOWIEM ONI POSIEDA ZIEMI.
BLO GOSLAWIENI KTORZY PLACZA, ALBOWIEM ONI BEDA POCIESZENI.
BLO GOSLAWIENI KTORZY LAKNA I PRAGNA SPRAWIEDLIWOSCI, ALBOWIEM ONI BEDA NASY CENI.
BLO GOSLAWIENI MILOSIERNI ALBOWIEM ONI MILOSIERDZIA DO STAPIA.
BLO GOSLAWIENI CZYSTEGO SERCA ALBOWIEM ONI BOGA OGLADAC BEDA.
BLO GOSLAWIENI POKOJ CZYNIACY ALBOWIEM NAZWANI BEDA SYNAMI BOZYMI.
BLO GOSLAWIENI KTORZY CIERPIA PRZEALADAOWANIE DLA SPLAWIEDLIWOSCI, ALBOWIEM OCH JEST KROLESTWO NIEBIESKIE21.
Il ne fait ainsi aucun doute qu’une cathédrale était l’un des lieux idéaux pour penser la mise en scène d’un tel opéra, compte-tenu du ton hagiographique du livret-prière d’Ionesco. Ceci étant dit, Maximilien Kolbe demeurant une œuvre sur les camps d’extermination, nous trouvons que le motif de la cathédrale, pour Ionesco et Probst, assumait une valeur symbolique ultérieure, relevant de tout ce que nous avons déjà abordé au sujet de l’invisibilité d’Auschwitz.
À Auschwitz, en quelque sorte, l’idée même de la mort avait été effacée : il n’y avait pas de sépultures car les cadavres des prisonniers passaient aussitôt par les fours crématoires, de manière à ce que les nazis puissent effacer toute trace du massacre. De même, il ne pouvait pas y avoir de rites de sépulture, autrement dit de funérailles, de rites religieux susceptibles d’accompagner symboliquement les morts vers l’au-delà. Maximilien Kolbe (le personnage historique), mort à Auschwitz, n’avait pas lui non plus eu de digne sépulture. Son cadavre, ainsi que celui de millions d’autres déportés d’Auschwitz, avait aussitôt été réduit en cendres et en fumée dans l’un des fours crématoires du camp. Or, si nous rassemblons tous ces éléments, nous réalisons que le choix de représenter un opéra en son honneur dans une cathédrale relevait non seulement du symbolique, mais aussi du poétique. En d’autres termes, c’est comme si sur la scène (d’une cathédrale), à travers cette représentation artistique de la mort de Père Kolbe, on célébrait par la même occasion ses funérailles – ces mêmes funérailles qu’il n’avait pas reçues à Auschwitz.
Dans le troisième acte de l’opéra, Maximilien Kolbe mourrait, et un chœur composé d’un groupe d’enfants polonais apparaissait soudainement sur le plateau commençant à chanter une Béatitude évangélique. Ce n’était évidemment que du théâtre : sur scène, il n’y avait pas le vrai prêtre polonais, pas plus que le chœur d’enfants à côté de lui au moment de sa mort. Pourtant, voir le prêtre mourir à l’intérieur du périmètre d’une cathédrale, avec un chœur d’enfants chantant une Béatitude évangélique derrière lui, devait être une scène certainement très cathartique et rédemptrice [Fig. 9]. Artistiquement, grâce à ce détour contextuel permis par cette mise en scène du martyr de Maximilien Kolbe dans une cathédrale, on ne pouvait imaginer meilleur hommage et salut à la figure du prêtre polonais.

[Fig. 9]
[1] Jean-Paul DUFIET, « Discours et musique dans Maximilien Kolbe (1988). Opéra d’Eugène Ionesco et de Dominique Probst », in Barbara WOJCIECHOWSKA (dir.), De la musique avant toute chose. Notes linguistiques et littéraires, Torino, L’Harmattan, 2015, p. 106.
[2] M. Henri Derouet assura la charge épiscopale de 1985 à 1998. Pour en savoir davantage à ce sujet, nous renvoyons à Bruno BÉTHOUART, « Les Évêques du diocèse d’Arras, Boulogne et Saint-Omer de la Révolution à nos jours », in Delphine HANQUIEZ, Laurence BAUDOUX-ROUSSEAU (dir.), Les cathédrales d’Arras. Du moyen âge à nos jours, Aire-sur-la-Lys, ateliergaleriéditions, 2020, p. 379-394.
[3] « Maximilien Kolbe et les doutes de Ionesco. Un opéra de Dominique Probst pour un "mystère" d'Auschwitz », Le Monde, 12 octobre 1989, URL : https://www.lemonde.fr/archives/article/1989/10/12/maximilien-kolbe-et-les-doutes-de-ionesco-un-opera-de-dominique-probst-pour-un-mistere-d-auschwitz_4132054_1819218.html.
[4] « L’opéra de Ionesco sur Maximilien Kolbe sera joué à la Cathédrale d’Arras », Église d’Arras, 15 septembre 1989 (15), p. 2.
[5] Dominique PROBST, « Son premier opéra : Dieu à Auschwitz », La revue [Revue de la S. A. C. D. (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques)], 6, 1994, p. 15. Pour une version intégrale de cet article, nous renvoyons également à : Eugène IONESCO, Dominique PROBST, Maximilien Kolbe, éd. critique et commentée par Marguerite Jean-Blain, Paris, Honoré Champion, 2005, p. 25-27.
[6] Pour une analyse détaillée de cet épisode concernant la mort de Maximilien Kolbe à Auschwitz, nous conseillons la lecture de la biographie écrite en 1960 par Père Antoine Ricciardi, lui aussi prêtre franciscain : Antoine RICCIARDI, Maximilien Kolbe, prêtre et martyr (1960), Paris, Mediaspaul, 1987.
[7] Preuve de cette fascination en était assurément cet extrait d’un poème écrit par Ionesco lui-même déjà en 1978, et donc bien avant de connaître Probst : « […] J’espère toutefois, on ne sait jamais,|que ce que j’ai fait, ce que j’ai écrit,|aura pu aussi, dans une bien moindre mesure, à mon insu,|aider quelqu’un.|Peut-on dire que je suis jaloux de Maximilien Kolbe ?|Pour moi, c’est la seule existence enviable,|la seule existence qui mérite d’être vécue,|qui justifie aussi bien la vie que la mort » (Cité d’après Eugène IONESCO, Dominique PROBST, Maximilien Kolbe, éd. critique et commentée par Marguerite Jean-Blain, op. cit., p. 9).
[8] Extrait d’un écrit de Bradecki que nous pouvions trouver, en postface, dans le volumen du premier livret de Maximilien Kolbe, distribué lors de la représentation de l’opéra à Rimini, en Italie : Tadeusz BRADECKI, « Note di regia/Notes du metteur en scène », in Eugène IONESCO, Maximilien Kolbe, Rimini, Guaraldi, 1988. Le volumen, qui était bilingue (français, italien), se présentait sous forme d’un parchemin pouvant se dérouler de gauche à droite et vice-versa. Il comprenait, dans l’ordre, c’est-à-dire de gauche à droite : une présentation générale du sujet du drame ; le texte de Maximilien Kolbe écrit par Ionesco et divisé en trois actes ; deux brèves postfaces d’Ionesco lui-même et de Prosbt ; les notes de régie de Tadeusz Bradecki ; et, enfin en guise de conclusion, un écrit de Mario Guaraldi, l’éditeur. Puisque le volumen était un parchemin, la numération des pages était par conséquent absente.
[9] Eugène IONESCO, Maximilien Kolbe, op. cit.
[10] Eugène IONESCO, Dominique PROBST, Maximilien Kolbe, éd. critique et commentée par Marguerite Jean-Blain, op. cit., p. 46 : « Au fond de la cathédrale, un grand orgue de 74 jeux, inauguré en 1964. Lors de la représentation de Maximilien Kolbe, un rideau noir le masquait. L’espace représenté sur la photographie de l’orgue et de la nef central recevait le public ».
[11] Nous avons déjà eu l’occasion de citer la critique du spectacle, tout à fait positive, publiée le 12 octobre 1989 dans les colonnes du journal Le Monde, La voix du Nord et Église d'Arras, deux journaux plus locaux, ne furent toutefois pas moins sensibles au projet. En particulier, nous renvoyons à l’article de Louis GUINARD, « J’ai joué dans Maximilien Kolbe », Église d'Arras, 20 octobre 1989 (17), p. 20-21.
[12] Voir, par exemple, la représentation qui a eu lieu en novembre 2019 à la Cathédrale de Southwark de Londres, dont nous pouvons trouver un compte-rendu à l’URL suivant : Peter YEATS, « Murder In The Cathedral by T.S. Eliot at Southwark Cathedral | Review », 6 november 2019, URL : https://www.lastminutetheatretickets.com/murder-in-the-cathedral-by-t-s-eliot-at-southwark-cathedral-review/.
[13] Il y aurait plusieurs interprétations de ce Vol de l’Ange de Brunelleschi. Pour la description du dispositif scénique, nous nous sommes basés sur l’analyse faite par Giorgio Vasari dans son ouvrage de 1550 Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Pour la référence bibliographique : Giorgio VASARI, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti (1550), Roma, Newton Compton, 2015.
[14] « L’opéra de Ionesco sur Maximilien Kolbe sera joué à la Cathédrale d’Arras », op. cit., p. 2.
[15] Ibid.
[16] Pour une analyse détaillée du spectacle de Gatti, voir Dorothy KNOWLES, « Armand Gatti and the silence of the 1059 days of Auschwitz », in Claude SCHUMACHER (dir.), Staging of the Holocaust. The Shoah in drama and performance, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 203-215.
[17] Nous empruntons cette expression à Shoshana Felman. Voir à ce propos Shoshana FELMAN, « À l’âge du témoignage : Shoah de Claude Lanzmann », in Bernard CUAU et alli, Au sujet de Shoah, Paris, Belin, 1990, p. 55-156.
[18] Par Sonderkommandos, nous entendons ces équipes de travail, composées de prisonniers, affectées dans les camps d’extermination nazis au fonctionnement des fours crématoires et des chambres à gaz.
[19] Si beaucoup a déjà été dit et écrit au sujet des camps d’extermination, notamment à travers les travaux des historiens et les témoignages des déportés eux-mêmes, il n’en demeure pas moins que les images du déroulement du massacre (chambres à gaz et crémation des corps) restent presque totalement absentes. Jean-Luc Godard avait beau les chercher dans les archives : « Les nazis avaient la manie de tout enregistrer. […] Les archives, on les découvre toujours longtemps après. Je n’ai aucune preuve de ce que j’avance, mais je pense que si je m’y mettais avec un bon journaliste d’investigation, je trouverais les images des chambres à gaz au bout de vingt ans. On verrait entrer les déportés et on verrait dans quel état ils ressortent. » [Cité d’après Antoine DE BAECQUE, « Godard et la Shoah », in Alain KLEINBERGER, Pierre MESNARD (dir.), La Shoah. Théâtre et cinéma aux limites de la représentation, Paris, Kimé, 2013, p. 116-117] C’est pourquoi, à la suite d’une exposition photographique sur les camps de concentration et d’extermination organisée à Paris en 2001, la publication du livre Images malgré tout de Georges Didi-Huberman, en 2003, a relancé le débat (Georges DIDI-HUBERMAN Georges, Images malgré tout, Paris, Les Éditions de Minuit, 2003). Dans ce livre, le critique d’art français analysait en détail quatre photographies prises secrètement en août 1944 par un membre du Sonderkommando. Ces images, qui constituent l’un des seuls témoignages visuels du travail des membres du Sonderkommando, sont très floues, l’appareil du photographe étant en mouvement. Cependant, dans son étude, Didi-Huberman nous invitait à comprendre ces quatre photographies précisément en raison de leurs limites esthétiques, d’autant plus susceptibles de laisser imaginer l’urgence de l’instant.
[20] Eugène IONESCO, Maximilien Kolbe, op. cit.
[21] Ibid. Afin de rapprocher encore davantage le chant de ce Chœur d’enfants de l’idée de la prière, Probst avait prévu un chant a cappella, c’est-à-dire un chant libre de toute intercession d’instruments musicaux. La Béatitude, ainsi que nous venons de le souligner dans le texte, était chantée en polonais, la langue maternelle de Père Kolbe. Le volumen de Rimini intégrait également la traduction française de la prière : « Bienheureux ceux qui ont l’esprit de pauvreté car le Royaume de Dieu est à eux.|Bienheureux les non-violents, ils posséderont la terre.|Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés|Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la Sainteté car ils seront rassasiés.|Bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde|Bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu.|Bienheureux ceux qui travaillent pour la paix, ils seront appelés fils de Dieu.|Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume de Dieu est à eux ».
Résumé
En 1981, le compositeur Dominique Probst entame une collaboration avec Eugène Ionesco en vue de la création d’un opéra. L’opéra, à caractère historique et religieux, s’intitulera Maximilien Kolbe, en hommage à la figure de Père Kolbe, martyr d’Auschwitz. En France, Maximilien Kolbe sera représenté pour la première fois en 1989 dans la Cathédrale d’Arras. Un opéra sur Auschwitz dans un lieu aussi sacré qu’une cathédrale : pourquoi ce choix ? Pourquoi une cathédrale et non, simplement, un théâtre ?
Abstract
In 1981, the composer Dominique Probst began a collaboration with Eugène Ionesco to create an opera. The opera, of historical and religious character, was entitled MK, in homage to the figure of Father Kolbe, martyr of Auschwitz. In France, the opera was performed for the first time in 1989 in Arras Cathedral. An opera about Auschwitz in a place as sacred as a cathedral: why this choice? Why a cathedral and not just a theatre?
Genèse de l’œuvre, jusqu’à la mise en scène de Bradecki à Arras, en 1989, dans la Cathédrale
Entre passé et présent : la cathédrale comme lieu théâtral idéal pour Maximilien Kolbe
Le choix de la Cathédrale pour le diocèse lui-même
La Cathédrale d’Arras pour Ionesco, Probst et Bradecki
Andrea GRASSI
Université de Franche-Comté, CRIT EA3224
andrea.grassi@univ-fcomte.fr
« Maximilien Kolbe et les doutes de Ionesco. Un opéra de Dominique Probst pour un "mystère" d'Auschwitz », Le Monde, 12 octobre 1989, URL : https://www.lemonde.fr/archives/article/1989/10/12/maximilien-kolbe-et-les-doutes-de-ionesco-un-opera-de-dominique-probst-pour-un-mistere-d-auschwitz_4132054_1819218.html.
« L’opéra de Ionesco sur Maximilien Kolbe sera joué à la Cathédrale d’Arras », Église d’Arras, 15 septembre 1989 (15), p. 2.
BÉTHOUART, Bruno, « Les Évêques du diocese de’Arras, Boulogne et Saint-Omer de la Révolution à nos jours », in Delphine HANQUIEZ, Laurence BAUDOUX-ROUSSEAU (dir.), Les cathédrales d’Arras. Du moyen âge à nos jours, Aire-sur-la-Lys, ateliergaleriéditions, 2020, p. 379-394.
DE BAECQUE, Antoine, « Godard et la Shoah », in Alain KLEINBERGER, Pierre MESNARD (dir.), La Shoah. Théâtre et cinéma aux limites de la représentation, Paris, Kimé, 2013, p. 387-400.
DIDI-HUBERMAN, Georges, Images malgré tout, Paris, Les Éditions de Minuit, 2003.
DUFIET, Jean-Paul, « Discours et musique dans Maximilien Kolbe (1988). Opéra d’Eugène Ionesco et de Dominique Probst », in Barbara WOJCIECHOWSKA (dir.), De la musique avant toute chose. Notes linguistiques et littéraires, Torino, L’Harmattan, 2015, p. 87-107.
FELMAN, Shoshana, « À l’âge du témoignage : Shoah de Claude Lanzmann », in Bernard CUAU et alli, Au sujet de Shoah, Paris, Belin, 1990, p. 55-156.
GUINARD, Louis, « J’ai joué dans Maximilien Kolbe », Église d'Arras, 20 octobre 1989 (17), p. 20-21.
IONESCO, Eugène, Maximilien Kolbe, Rimini, Guaraldi, 1988.
—, PROBST, Dominique, Maximilien Kolbe, éd. critique et commentée par Marguerite Jean-Blain, Paris, Honoré Champion, 2005.
KNOWLES, Dorothy, « Armand Gatti and the silence of the 1059 days of Auschwitz », in Claude SCHUMACHER (dir.), Staging of the Holocaust. The Shoah in drama and performance, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 203-215.
PROBST, Dominique, « Son premier opéra : Dieu à Auschwitz », La revue [Revue de la S. A. C. D. (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques)], 6, 1994, p. 15-18.
RICCIARDI, Antoine, Maximilien Kolbe, prêtre et martyr (1960), Paris, Mediaspaul, 1987.
VASARI, Giorgio, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti (1550), Roma, Newton Compton, 2015.
YEATS, Peter, « Murder In The Cathedral by T.S. Eliot at Southwark Cathedral | Review », 6 november 2019, URL : https://www.lastminutetheatretickets.com/murder-in-the-cathedral-by-t-s-eliot-at-southwark-cathedral-review/.