
L’analyse des portraits fugitifs et en mouvement des premiers metteurs en scène de cinéma est une entreprise qui relève de la gageure, tant les sources sont rares. Elle repose sur un paradoxe : ceux-là mêmes qui orchestrent la mise en scène au cinéma et filment leurs contemporains, qu’ils soient artistes, hommes et femmes de lettres, peintres, actrices et acteurs, restent dans le hors-champ des premiers portraits en mouvement. La rareté des sources permet en premier lieu d’établir le constat d’une invisibilité paradoxale qu’il s’agit de comprendre.
Les archives filmiques se présentent sous différentes formes. Parmi elles, les making of dressent des portraits fugaces des metteurs en scène au travail. Ainsi, en 1907, Alice Guy est filmée en train d’orchestrer le tournage d’une phonoscène1. Dès 1920, d’autres metteurs en scène rejoignent Mademoiselle Alice sur la pellicule : Henri Diamant-Berger et Abel Gance peuvent se targuer de laisser tous deux des témoignages vivants de leur travail dans les bureaux ou sur les plateaux de cinéma. Les génériques constituent d’autres sources intéressantes pour notre sujet : le metteur en scène est exposé à travers son portrait filmique, sur quelques secondes à peine, révélant ainsi son visage aux spectateurs. Abel Gance signe ainsi La Dixième symphonie (1918), par l’intermédiaire de son portrait vivant, apparaissant au générique de fin2. Enfin, un bref portrait en mouvement d’André Antoine (non daté mais très certainement réalisé peu avant la sortie de son premier film, Les Frères corses en 1917) laisse un témoignage précieux de ce type de pratique précoce3.
Il est souvent bien délicat de connaître l’origine de ces images, leur contexte de fabrication comme de diffusion, bref, d’établir le contexte et la relation sociale qu’elles engagent (entre le filmeur et le filmé et plus largement entre la production et le metteur en scène). Leur datation exige même parfois une enquête, comme en témoigne l’exemple d’Antoine. Les portraits en mouvement fonctionnent souvent comme des énigmes à interpréter. Les making of demeurent assez mystérieux relativement à leur circulation. Les catalogues mentionnent parfois la date de diffusion (qui correspond à celle de leur réalisation) mais taisent le contexte de projection initial. La rareté et le manque d’informations relatif à la circulation de ces portraits en mouvement auprès du public, rendent donc délicate leur interprétation. Enfin, leur brièveté ne les apparente guère à un discours construit (sur le metteur en scène comme artiste et/ou comme industriel voire sur le cinéma). Un constat s’impose donc : leur analyse ne peut se faire qu’en corrélation avec d’autres sources qui les éclairent. Sont donc convoquées dans cette communication d’autres sources à l’aune desquelles les portraits fugitifs font sens pour mieux évaluer le statut du portraituré et les règles qui en guident la représentation : Mémoires, films de fiction, articles de presse, etc.
La mise en scène au cinéma relève d’une profession aux contours encore flottants, qui repose sur des critères intellectuels aussi bien que techniques et pragmatiques, rendant le métier difficile à appréhender et donc à représenter. Loin d’être seul dans son atelier ou dans son bureau, accoudé à sa table d’écriture ou devant sa bibliothèque, entouré de tableaux ou de sculptures – comme le montre le riche catalogue Dornac4 pour les écrivains et artistes de la même époque – le metteur en scène de cinéma s’appréhende plus difficilement. Il met le photographe et le metteur en scène au défi de représenter le travail intellectuel au service d’une industrie. Comment faire le portrait de celui qui est lui-même une énigme, à cheval entre le représentant du « prolétariat intellectuel »5 et de l’artiste singulier ? Comment faire le portrait d’un homme artiste au service d’un travail collectif ? Comment représenter le travailleur qui fait coïncider ce que l’on voit à l’époque comme « les ingrédients traditionnellement considérés comme supérieurs (ou artistiques), le texte, les comédiens, [et] ceux d’ordre inférieur, la technique »6 pour reprendre la formule employée par Éric de Kuyper dans son article sur l’invention de la mise en scène au XIXe siècle ? Le portrait en mouvement fonctionne à la manière d’une synecdoque : il évoque toujours plus que l’homme ou l’artiste, au point de l’occulter derrière l’industrie, la technique – la ruche qu’est le studio sert souvent de décor – ou le commerce, autant d’éléments qui paraissent peu conciliables avec l’idée de l’art répandue au XIXe siècle.
Le premier making of identifié dans le cadre de cet article est celui qui enregistre, en 1907, le tournage d’une phonoscène par Alice Guy7, la « doyenne des femmes metteurs en scène »8 comme elle l’écrit elle-même dans ses Mémoires, publiés en 1976. Ce portrait n’a rien d’intimiste. Le film s’ouvre dans l’obscurité et révèle progressivement le plateau. La caméra, placée en légère plongée derrière l’appareillage des lumières et de la prise de vues, montre Mademoiselle Alice qui revient du plateau pour régler la machine d’enregistrement du son, après avoir donné des indications de jeu aux actrices et aux acteurs et avant de vérifier que son opérateur de prise de vues est bien prêt pour l’enregistrement. La caméra effectue un léger panoramique gauche droite puis droite gauche pour satisfaire la curiosité du spectateur en montrant le lourd appareillage dont il est abondamment question dans ses Mémoires9. Le dos d’Alice Guy, ses va-et-vient vers les autres membres présents sur le plateau, son retour à une position centrale disent l’absorbement de la metteuse en scène au travail. Le portrait en mouvement, relativement à la photographie, permet ici de « se détourne[r] du spectateur pour « plonger dans l’acte aux dépens […] de la pose »10. Le naturel de l’image en mouvement réside dans son affranchissement vis-à-vis de la représentation : « on privilégie l’évènement aux dépens de l’exposition »11. On plonge dans le faire qui se déroule sous nos yeux et qui libère le sujet du paraître émanant habituellement de la pose (photographique). Le cinéma prend ici habilement la relève de la modernité picturale théorisée par Diderot lorsqu’il s’agit de représenter des figures de dos : « l’insoumission à l’égard du spectateur » est affichée, de même que « l’Homme qui agit » au détriment de « l’Homme qui se montre »12.
Même si Alice Guy est présente dès le titre du film et occupe l’espace plus que n’importe quelle autre personne présente sur le plateau par sa position et ses mouvements, il paraît délicat d’associer ce making of à la tradition picturale ou photographique de l’artiste à l’œuvre. L’appareillage technique – éclairage et caméra, enregistrement du son – vole la vedette au metteur en scène, comme en atteste la forme filmique qui va de l’obscurité à la lumière (pour rendre compte des conditions de travail) et de gauche à droite (pour filmer la monumentalité du dispositif phono-cinématographique davantage que celle que l’on ne considère pas encore comme l’auteure du film).
La technique, avant de devenir une des conditions de l’art cinématographique par l’intermédiaire de sa maîtrise, va inciter ses contemporains à penser le cinéma comme un outil d’enregistrement mécanique plus ou moins complexe. Dans ces conditions, un bon film est avant tout un film qui se vend bien13. Le metteur en scène, comme tous ceux qui participent à la jeune industrie est réduit à « un substrat collectif »14 et a la réputation d’être « assujetti aux règles strictes d’une formule »15, leur personnalité étant réduite à néant, selon différents témoignages.
L’idée même de la mise en scène cinématographique comme travail artistique émerge, à la faveur de différents évènements, avant de s’imposer dans les années 1910. Plusieurs sources de l’époque en attestent, à commencer par la publication, en octobre 1908, d’un article dans L’Illustration qui participe au lancement d’une nouvelle structure de production cinématographique : le Film d’Art. L’article est agrémenté de photographies de tournage valorisant les metteurs en scène, Charles Le Bargy et André Calmette, sur le tournage du Retour d’Ulysse. Il s’agit d’un des premiers films de cette société, qui entend s’assurer le concours d’artistes variés – et célèbres ! – à l’industrie du cinéma. Dans ce reportage, une place toute spéciale est consacrée aux metteurs en scène, aussi bien par les photographies de tournage – fait novateur – que par le texte, qui entend présenter « un théâtre extraordinaire et infidèle aux traditions les plus sacrées »16. Celui qui tient le premier rôle dans ce récit est sans conteste le metteur en scène à qui l’on reconnaît l’autorité naturelle, le pragmatisme et le talent pour « réaliser artistiquement »17 la scène.
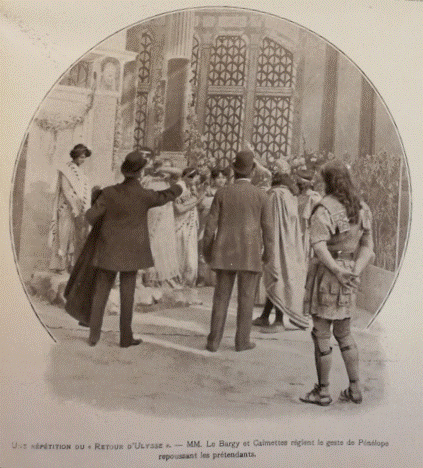
Fig. 1 : Photographie de tournage du Retour d’Ulysse avec Le Bargy et Calmette de dos, réglant la mise en scène. BnF - Rf64323
Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, de trouver les premiers génériques au sein de ces films d’art qui présentent autant de portraits en mouvement des interprètes. Dans certains cas, l’interprète est aussi le metteur en scène, ce qui explique les portraits fugitifs de Georges Berr dans Les Précieuses ridicules (1909)18 ou encore d’André Calmettes dans Madame de Langeais (1910)19. Mais dans ces exemples, c’est davantage l’interprète que le metteur en scène qui est filmé, comme en atteste leur costume de scène. La correspondance entretenue entre les artisans du Film d’Art prouve aussi l’exploitation marchande des noms et portraits des comédiens célèbres, censés « compenser les dépenses énormes qu’entraîn[e] la mise sur pellicule [des scénarios] »20. Néanmoins, l’adresse directe au public et le salut permettent de présenter leur portrait dans un entre-deux de la représentation (le film n’évoque à proprement parler ni la réalité – le metteur en scène se redouble du personnage par l’intermédiaire de son costume – ni la fiction – le salut et le regard caméra empêchent l’immersion du spectateur dans la diégèse).
À cette période, le cinéma n’est plus exclusivement dirigé par « l’esprit industriel » dans lequel il était cantonné depuis le passage à la production de masse au sein des grands studios en 190521. Il se développe aussi du côté du film de qualité, imposé par des bandes de plus en plus longues et de plus en plus ambitieuses qui imposent l’évidence de la mise en scène au cinéma. Étonnamment, ce sont les sources juridiques qui proposent les premiers textes théoriques pertinents sur le cinéma22. En 1908, paraît un article dans Les Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire qui questionne la nature du cinéma pour en arriver à la conclusion suivante :
Qu’est-ce en effet que le cinématographe ? La photographie de mouvements, d’action. Si cette action n’est pas naturelle, mais combinée, si elle est imaginée par quelqu’un, il faut bien convenir qu’elle est un produit de l’intelligence et que son auteur a droit à la protection donnée par la loi aux œuvres intellectuelles23.
La même année, Charles Pathé commande à deux juristes la rédaction d’un texte qui établit par la preuve que la mise en scène au cinéma relève d’un travail artistique. Le cinéma est assimilé au dessin et à la gravure au motif qu’il exprime tout autant que ceux-ci « une idée en la traduisant par une forme »24. Il s’agit de reconnaître que le cinéma ne se réduit pas à un simple enregistrement mécanique mais relève de la mise en scène : « c’est la traduction de la pensée par la matière »25 ; « l’appareil devient un instrument comme un pinceau dans les mains du peintre, le ciseau dans les mains du sculpteur »26. La mise en scène au cinéma relève d’une « production de l’esprit »27. C’est à la faveur de ce changement de perception que certains films de fiction s’élaborent autour de la figure du metteur en scène de cinéma qui devient alors le personnage principal de plusieurs films.
Les premiers portraits en mouvement du metteur en scène de cinéma sont à chercher du côté de la fiction. Plusieurs films valorisent la fonction au point d’en faire le métier – ou plutôt l’art – du personnage principal, à l’exemple des films Les Béquilles (1911), Les Bretelles (1913) ou encore Dernier amour (1916), de Léonce Perret28. On sort ici de l’usage communicationnel du portrait qui montre exclusivement la position sociale du personnage créée par l’industrie cinématographique, au profit d’une construction socio-professionnelle et biographique par l’image (on nous compte aussi les amours du metteur en scène, comme le dernier titre l’indique). Notons qu’une brève scène de Dernier amour présente le cinématographiste comme peintre, accentuant la nature artistique et sensible du portraituré. Léonce Perret choisit cependant de ne pas interpréter le personnage du metteur en scène – alors même qu’il est lui-même acteur –, laissant ce rôle au comédien René Cresté. La mise en scène du « réalisateur », sous les traits d’un acteur, est d’autant plus habile qu’elle indique par son absence à l’image, sa forte présence implicite dans les coulisses de la fabrication. Le personnage rend visible et incarne le metteur en scène pour mieux mettre en évidence le travail d’élaboration que requiert l’art cinématographique. Au même moment, Léonce Perret milite lui-même pour que soit reconnus son métier et les qualités qu’il exige29.
Si les portraits fictionnels de metteurs en scène tendent à valoriser leur travail et leur art, il n’en va pas exactement de même des premiers portraits fugitifs dits « documentaires ». Les portraits fugitifs de metteurs en scène s’ancrent bien évidemment, industrie oblige, dans la tradition de l’homme illustre qui sert à faire vendre – un spectacle comme n’importe quel produit manufacturé30. Son portrait, fixe ou en mouvement, sert bien évidemment des intérêts économiques et se voit instrumentalisé assez tôt dans l’histoire du cinéma. L’exemple emblématique de cette tendance – qui met en évidence le désaccord entre le metteur en scène et la société de production, soit entre l’artiste et l’industrie – est le portrait en mouvement d’André Antoine, réalisé très certainement à la demande de Pathé, pour la sortie de son premier film Les Frères corses (1917). Notons que l’affiche du film propose un portrait du metteur en scène, ce qui en soit est un fait relativement rare, comme le note Manon Billaut : « la présence du portrait du metteur en scène » – et son nom pourrait-on ajouter ! –, « est un cas unique dans l’histoire de l’affiche de cinéma des années 1910 »31. À cette date, les sociétés de production ornent les affiches du portrait de l’auteur des livres dont sont tirées les adaptations32, voire de l’auteur des « scénarios » (on parle ici de versions littéraires exclusivement). C’est la position éminente d’Antoine comme metteur en scène de théâtre et père du Théâtre Libre qui explique la double réalisation de portraits photographique et filmique. Ce dernier devait initialement être projeté parmi les actualités, juste avant la projection du film de fiction : « Suzanne Gugenheim insist[e] ainsi à la fin du mois d’octobre pour qu’Antoine se laisse filmer afin de présenter le metteur en scène en ouverture du film, ce qui en retard[e] la sortie »33. L’origine de cette demande est donc avant tout commerciale, le modèle se prêtant de mauvaise grâce à un exercice auquel il répugne. Antoine a l’occasion de s’exprimer sur cette tendance qu’il exècre34. En conséquence, le portrait ne donne pas une image plaisante du metteur en scène. Le portrait fugitif semble révéler ici les conditions de sa prise de vues et le désaccord relatif entre la société de production et le modèle. Son refus d’obtempérer s’observe dans ses gestes et légers mouvements : il fume et se meut devant la caméra en refusant de prendre la pose ou de sourire, ne sachant que faire de son corps et se sentant observé. Sa considération vis-à-vis de la caméra se limite à un regard caméra tardif assez sévère. Nullement à l’aise, le metteur en scène paraît relativement bougon. Néanmoins, le portrait en mouvement permet ici – et pas seulement du fait des conditions de tournage – d’instaurer un nouveau rapport entre le spectateur et le metteur en scène. La distance qui sied d’ordinaire aux portraits photographiques, mis en scène et abondamment réfléchis, n’est plus de mise avec le cinématographe qui instaure ici le naturel des mouvements, la singularité physique et comportementale du portraituré. La caméra à hauteur d’homme et le décor neutre, qui empêchent d’inscrire le modèle dans un milieu spécifique, créent une sorte de rapprochement avec lui. Il n’est plus auréolé de son prestige – transmis précédemment par des accessoires, une pose, un décor bref, une mise en scène –, il devient accessible, dans sa simplicité d’homme de tous les jours. C’est ce qui paraît aujourd’hui constituer la plus grande force et la plus grande faiblesse de ce portrait fugitif : le portrait donne un sentiment ambivalent. Il est la traduction d’une modernité dans la représentation, d’un rapport plus simple et direct au modèle mais il empêche en cela Antoine de se caractériser véritablement comme différent du commun des mortels.
Si Antoine rechigne à voir son portrait fixe ou en mouvement circuler, il n’en va pas de même des metteurs en scène de la deuxième génération. Parmi eux, le superbe Abel Gance qui non content de s’exprimer dans la presse et de voir ses films plébiscités par la critique et le public, décide de marquer l’imagerie de son film, La Dixième symphonie (1918)35, par l’intermédiaire de son portrait fugitif qui vaut comme salutation au public et générique de fin. La signature visuelle et animée inscrit le metteur en scène « dans la bibliothèque universelle des auteurs […], dans le musée des grands artistes »36. C’est à la toute fin du film, sur dix secondes, qu’Abel Gance apparaît, sur fond noir, le regard vif, esquissant un sourire aux spectateurs du film qui s’achève à peine. La position de ce portrait fugitif au générique de fin n’est pas anodine. Le générique d’ouverture présentait déjà l’auteur par la mention suivante : « Abel Gance. Auteur metteur en scène ». La mention écrite de fin de film s’efface progressivement devant le portrait en mouvement. On observe d’abord le metteur en scène qui regarde en hors-champ, au loin, dans la tradition picturale initiée à la Renaissance et qui permet de signifier que l’œuvre, et à travers elle l’homme, survivront à sa mort physique. Après quoi, il gratifie le spectateur d’un regard-caméra et d’un commentaire qui reste muet. Ce portrait permet au metteur en scène de marquer l’imagerie de son film de son empreinte en présentant son visage en plan rapproché : il affirme l’identité d’Abel Gance, artiste. Car ce portrait fugitif au générique est à envisager comme partie intégrante du discours filmique sur l’art et la création. Le portrait cinématographique perpétue la tradition picturale du portrait d’artiste en signifiant davantage que la représentation du sujet. Le portrait est littéralement pris dans le temps et le déploiement de l’œuvre filmique : c’est « l’intention esthétique qui guide son invention »37.
Le film conte la rencontre amoureuse entre une jeune femme au passé trouble et un compositeur célèbre à qui la douleur inspire une symphonie. On peut y voir aussi un « métadiscours plastique assumé par l[’]œuvre, dans sa manière de représenter »38 les autres arts et de « se les réapproprier »39. La référence directe à la peinture est évidente via le portrait fugitif, mais la musique n’est pas en reste : Gance se confond avec le personnage du compositeur de musique qu’il met en scène. Il écrit d’ailleurs lui-même qu’« un grand film doit être conçu comme une symphonie, dans le temps et dans l’espace. […] Le cinéma doit devenir un orchestre visuel aussi riche, aussi complexe, aussi monumental que ceux de nos concerts »40. Ce fait est d’autant plus notable, et le pari est d’autant plus réussi, qu’un critique désigne son auteur comme « compositeur de belles images »41 à la sortie du film. Louis Delluc lui reconnaît « avoir le premier cherché la formule artiste du cinéma »42 en citant précisément la Dixième symphonie. Léon Moussinac écrit à propos de ce même film que « tant d’images vibrantes et profondes trahissaient l’émotion créatrice de l’artiste »43. Ce portrait fugitif affirme l’instance d’énonciation du film en éclipsant la société de production au profit du metteur en scène devenu artiste. Celui-ci apparaît valorisé, par une image en mouvement qui le met en scène à son avantage et qui établit une relation directe mais distante avec le spectateur (qui n’entend pas sa voix). C’est le regard du spectateur qui va précisément l’instituer artiste. L’entreprise semble ici faire aboutir le vœu de reconnaissance du cinéma comme art à travers la figure du metteur en scène devenu objet de représentation et auteur de son film44.
Le portrait en mouvement du metteur en scène gagne véritablement ses lettres de noblesse dans les années 1920, avec l’apparition et la généralisation des making of. Henri Diamant-Berger semble initier cette pratique en 1921, lors du tournage des Trois Mousquetaires45. Le court film débute par un plan bref où l’on voit Henri Diamant-Berger assis devant sa table de travail – la caméra lui fait face –, dans son bureau. À l’arrière-plan, on voit sa secrétaire qui tape un texte à la machine. Des tableaux aux murs et un mobilier singulier (un meuble en marbre ou imitation marbre notamment) décorent l’ensemble. Diamant-Berger, en costume-cravate devant des papiers étalés sur son bureau, conduisant de sa main gauche sa pipe à la bouche, décroche son téléphone de la main droite et entame une conversation qui reste muette pour le spectateur. Tout dans cette courte scène (moins de 7 secondes) révèle la manière dont est pensé le film : le fondu au noir qui permet l’enchaînement avec le plateau de tournage montre le souci de la ponctuation. Ce making of conte les coulisses de la production, orchestrée sous ses directives – d’où le portrait filmique – avant même que le tournage ne débute. Diamant-Berger souhaite montrer au public le travail de préproduction que requiert un film comme les Trois Mousquetaires. Il faut dire qu’il réalise ce film de retour des États-Unis où il a visité les studios hollywoodiens : « Sam (Goldwyn) m’entraîne à son bureau et me montre comment il établit ses plans de travail, ses ordres de tournage, comment il compose ses équipes techniques, comment les budgets de dépenses sont prévus et contrôlés », écrit-il dans ses Mémoires46. Dans l’hebdomadaire qu’il dirige depuis 1916, Le Film, il a soin d’expliquer que parmi les mesures à prendre pour relancer le cinéma français, la plus importante est celle qui consiste à considérer l’écriture scénaristique et la préparation des films en amont47. Aussi ce portrait en mouvement présente-t-il le metteur en scène dans les différentes phases de travail que requiert sa fonction : préparatifs de tournage, établissement du plan de travail, collaboration à plusieurs, gestion des costumes et du personnel de studio, etc. Le film a aussi pour but, lorsqu’il ne montre pas directement Diamant-Berger à l’écran, de montrer le spectaculaire de certaines scènes et la masse de figurants lors du tournage, afin que le spectateur relie d’autant mieux le metteur en scène à l’orchestration du film. Cette association peut aussi se faire sur la base du lieu de tournage du making of : les épées, bijoux et autres accessoires utilisés pour le tournage sont filmés, à titre d’exemple, devant le meuble en marbre (ou imitation marbre) que le spectateur reconnaît comme celui du bureau du metteur en scène. On peut donc légitimement se demander si le bureau du metteur en scène n’a pas été reconstitué en studio pour les besoins du portrait animé… Habile mise en scène qui reprend les conventions photographiques de l’écrivain au travail dans ce qui se veut être son environnement familier et singulier. Les images photographiques de Dornac servent certainement d’imaginaire structurant à la mise en scène du portrait animé.
Diamant-Berger reconduit la pratique du making of lors du tournage de Vingt ans après (1922)48. Cette fois-ci, le metteur en scène est introduit en plan américain, sur le plateau de tournage vide. Cette introduction par le vide et la solitude du metteur en scène qui contraste avec le foisonnement du plateau rempli par la suite, permet au spectateur d’imaginer le travail de préparation requis et l’exigence de la mise en scène. Dans les deux cas, le portrait en mouvement du metteur en scène est intégré au reste du film qui présente les acteurs, les préparatifs du tournage et certaines scènes spectaculaires projetés en amont de la projection des films de fiction. En 1925, Abel Gance continue sur la lancée d’Henri Diamant-Berger mais ne propose pas dans le making of de Napoléon49 de portrait fugitif de sa personne isolée au sein du studio. Le but du film est davantage de montrer le travail de répétition, de direction d’acteur et l’ambiance bon enfant avec blagues potaches entre le metteur en scène et son opérateur de prise de vues. Il est représenté affairé, de dos, reconduisant la tradition initiée par Alice Guy, mais sous le parfait contrôle du metteur en scène, dans sa stratégie de communication avec le spectateur.
La lente apparition des portraits filmés des premiers metteurs en scène de cinéma s’explique par l’émergence relativement tardive de leur statut. Industrie avant que d’être art, le cinéma conditionne la perception de ceux qui le font et retarde leur représentation (et même leur présentation !) aux yeux du public. Dès les premières tentatives de portraits, le metteur en scène s’éclipse malgré lui au profit de l’appareillage technique et celui du studio qui happe l’œil par l’exotisme de son microcosme insolite. Il faut finalement attendre l’intérêt commercial que porte le studio au metteur en scène pour découvrir un premier portrait fugitif où seul le modèle importe. Pris dans le jeu d’un contexte industriel et social, le portrait reste souvent assujetti à ses impératifs. C’est véritablement lorsque la conscience se fait de l’importance du portrait animé dans la communication au public que celui-ci devient richement signifiant, à l’égal du portrait pictural ou photographique.
[3] Récemment, Manon Billaut et Elodie Tamayo ont co-signé un article dont le présent travail reprend deux sources importantes : le portrait « commercial » d’André Antoine et la signature visuelle au générique de Mater Dolorosa d’Abel Gance. Manon BILLAUT et Élodie TAMAYO, « André Antoine et Abel Gance : deux auteurs de film ? », dans Clément PUGET et Laurent VÉRAY (dir.), À la recherche de l’Histoire du cinéma en France (1908-1919) : lieux, sources, objets, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2022, p. 303-334. Néanmoins, l’angle d’approche est différent : il s’agit ici davantage de questionner la représentation du metteur en scène, à travers le portrait filmique, que son statut « d’auteur » comme le font les deux chercheuses précédemment citées. C’est la mise en scène filmique en tant que telle qui est interrogée ici, et ce, dans l’économie globale de ce type de portraits en mouvement. Nous en proposons une analyse esthétique en corrélation avec d’autres sources qui élargissent le propos au metteur en scène dans sa dimension sociologique.
[4] Je remercie Martine LAVAUD d’avoir partagé Le Catalogue inédit de l’œuvre de Dornac (non encore édité), montrant « 531 visages insérés dans leurs décors domestiques et/ou professionnels ».
[5] Silvio ALOVISIO, Voci del silenzio. La sceneggiatura nel cinema muto italiano, Milano, Il castoro, 2005. L’auteur utilise cette expression à propos du scénariste mais elle me semble tout à fait transposable au metteur en scène qui dirige son équipe dès 1908, suite à la division des aires de compétence au sein des studios français.
[6] Éric DE KUYPER, « Une invention méconnue du XIXe siècle : la mise en scène », dans Jacques Aumont (dir.), La Mise en scène, De Boeck Supérieur, 2000, p. 13-24.
[7] « Alice Guy tourne une phonoscène dans les studios des Buttes-Chaumont », Gaumont-Pathé Archives, référence 1907GDOC 00001. https://gparchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=275441&rang=1.
[8] Alice GUY-BLACHÉ, Autobiographie d’une pionnière du cinéma : 1873-1968, Paris, Denoël/Gonthier, 1976, p. 1.
[9] Elle raconte : « Pour remédier à l’absence trop fréquente de soleil, on avait construit deux lourdes herses supportant 24 lampes de 30 ampères que nous procuraient de fortes insolations électriques. Que de soirées j’ai passées à demi aveugle, les yeux larmoyants, sans pouvoir lire. […] Personnellement, j’en ai conservé un rétrécissement de la rétine, parfois bien gênant ». Alice GUY-BLACHÉ, op. cit., p. 70.
[10] Georges BANU, L’Homme de dos. Peinture, théâtre, Paris, Adam Biro, 2001, p. 69. En italique dans le texte.
[11] Ibid.
[12] Ibid. Le tableau de Pierre Paul RUBENS, Retour des paysans des champs (vers 1640, Florence, Palais Pitti) illustre le texte.
[13] Henri FESCOURT, La Foi et les montagnes ou le septième art au passé, Paris, Paul Montel, 1960, p. 56.
[15] Victorin JASSET, « Étude sur la mise en scène » Ciné-Journal, n°165, le 21 octobre 1911, p. 51.
[17] G. B., Art. cit., p. 287.
[18] Le film est conservé à Bois d’Arcy. Il a été numérisé et est consultable sur un poste CNC à la BnF.
[19] « Madame de Langeais », Gaumont-Pathé Archives, référence 1910CFPFIC 00198 https://gparchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=333439&rang=1.
[20] Voici le contenu d’une lettre de Richard CANTINELLI envoyé à Henri LAVEDAN : « il importe, en regardant les choses du point de vue commercial, que le nom de Le Bargy figure sur le film à côté des noms de Hading et de Lambert pour compenser les dépenses énormes qu’entraînera la mise sur pellicule de ce scénario (décors, costumes, figuration, paiement des artistes, etc.) ». « Lettres de Richard Cantinelli à Henri Lavedan », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 56 | 2008, mis en ligne le 01 décembre 2011, consulté le 27 juin 2022. URL : http://journals.openedition.org/1895/4052. ; DOI : https://doi.org/10.4000/1895.4052.
[21] Laurent LE FORESTIER, Aux sources de l’industrie du cinéma : le modèle Pathé, 1905-1908, Paris, L’Harmattan, A.F.R.H.C., 2006.
[22] À ce propos, voir le texte écrit par Emmanuelle TOULET, en préface de l’ouvrage d’Alain CAROU : Le cinéma français et les écrivains : histoire d’une rencontre (1906-1914), Paris, École nationale des Chartes, A.F.R.H.C, 2002.
[23] Fernand IZOUARD, « Le cinématographe et le droit d’auteur », Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire, Art. 4727, 1908, p. 158. C’est moi qui souligne.
[24] Émile MAUGRAS et Maurice GUÉGAN, Le Cinématographe devant le droit, Paris, V. Giard & E. Brière libraires-éditeurs, 1908, p. 5.
[25] Ibid. p. 6.
[26] Ibid. p. 29.
[27] Ibid. p. 32.
[28] Cette liste est loin d’être exhaustive. Nous pouvons également citer à titre d’exemple Les Débuts de Max au cinématographe, de Max Linder (1912) ou encore Rigadin aux Balkans de Georges Monca (1912) qui met en scène un opérateur en tournage.
[29] Voir notamment la grande enquête coordonnée par Henry RIGAL, « D’où vient cette crise de l’industrie cinématographique et quels problèmes soulève-t-elle ? », La Renaissance, politique, littéraire, artistique d’août à septembre 1616. Léonce Perret s’y exprime le 16 septembre, n°19, p.17-18.
[30]
« Au XIXe siècle, les images de publicités, affiches,
étiquettes, se multiplient. Collées sur un mur, enveloppant un produit, elles
ont une double fonction d'information et de séduction. La figure de Hugo est
ainsi largement utilisée pour faire vendre des plumes, de l'encre, des élixirs
et même des vêtements. L'information est toujours la même : chaque fois,
le producteur joue sur une possible identification du consommateur à l'écrivain
et au patriarche, ou plutôt sur un rêve d'identification : quel est
l'homme du XIXe siècle qui n'a pas rêvé d'être un aussi grand
écrivain que Hugo, d'être fort et bon comme lui, bref de
« ressembler » à Hugo, et de pouvoir se dire, au moins
secrètement : "Hugo c'est nous", "Hugo c'est moi" ou
encore "Je serai Hugo !![]() » La Gloire de Victor Hugo [Exposition, Paris,
Grand Palais 1985/1986], Paris, Éd. de la réunion des musées nationaux, 1985,
p. 153.
» La Gloire de Victor Hugo [Exposition, Paris,
Grand Palais 1985/1986], Paris, Éd. de la réunion des musées nationaux, 1985,
p. 153.
[31] Manon BILLAUT, « André Antoine au cinéma : une méthode expérimentale », thèse de doctorat en études cinématographiques, sous la direction de Laurent Véray, Université Paris 3, soutenue le 18 décembre 2017, p.185. La thèse a été publiée : Manon BILLAUT, André Antoine au cinéma : une méthode expérimentale, Paris, éd. Mimésis, 2021. Voir également à ce propos Manon BILLAUT et Élodie TAMAYO, op. cit., p. 318-319.
[32] À titre d’exemple, voir l’affiche des Misérables, adaptation de Victor Hugo par Albert Capellani, sortie en 1912 (Cinémathèque française, A013-066) ou celle du Cœur d’Yvonette où l’on voit un médaillon avec le portrait de Daniel Riche, « scénariste » du film (Cinémathèque française, A181-058).
[33] Manon BILLAUT, op. cit., p. 187.
[34] Ibid.
[35] Le film est disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=emxiGAkurMg
[36] Chantal QUILLET, Jean-Luc MARTINEZ (dir.), Figure d’artiste, [exposition, Paris, Musée du Louvre, Petite galerie, 25 septembre 2019-29 juin 2020], Paris, Seuil, Louvre éditions, 2019, p. 18.
[37] Ibid. Á ce sujet voir aussi Manon BILLAUT et Élodie TAMAYO, op. cit., p. 319-320.
[38] Valentine ROBERT, « Introduction. Fictions de création : la peinture en abyme et le cinéma en question », dans Laurent LE FORESTIER et Gilles MOUËLLIC (dir.), Filmer l’artiste au travail, Rennes, Presses universitaires de Rennes,2013. https://books.openedition.org/pur/74862.
[39] Ibid.
[40] Abel GANCE, « L’harmonie visuelle est devenue symphonie », conférence prononcée le 22 mars 1929, dans Pierre LHERMINIER, L’Art du cinéma, Paris, Seghers, 1960, p. 164-165.
[41] Louis DELLUC, Écrits cinématographiques I. Le cinéma et les cinéastes, Paris, Cinémathèque français, Éd. Pierre LHERMINIER, 1985, p. 166.
[42] Louis DELLUC, Écrits cinématographiques II. Cinéma & Cie, Paris, Cinémathèque française, éd. établie et présentée par Pierre Lherminier, 1986, p. 233.
[43] Valérie VIGNAUX (dir.), avec la collaboration de François ALBERA, Léon Moussinac : critique et théoricien des arts. Anthologie critique, Paris, A.F.R.H.C., 2014, p. 108. Notons que ces textes ont participé au mythe de la naissance du cinéma comme art dans les années 1920, éclipsant les œuvres méconnues et importantes de la décennie précédente.
[44] Un autre exemple de générique pourrait être cité mais a été écarté de cette étude : Albert Capellani apparaît au générique de Quatre-vingt-treize (1921), sur plusieurs photographies juxtaposées, dont le film orchestre la succession. Ce dernier exemple place ce types d’images entre la fixité et le mouvement, entre la photographie et le film. Mais la source est trompeuse : les photographies d’Albert Capellani ont très certainement été ajoutées lors de la restauration du film par Philippe Esnault, dans les années 1980. Esnault se laisse la liberté d’intégrer des éléments exogènes aux films, comme des portraits photographiques qu’il trouve conservés à la Cinémathèque française et qu’il intègre aux génériques, sans grand souci de l’original filmique et de l’historicité de la source. Ce portrait en mouvement instaure à lui seul un anachronisme évident relativement à la perception du metteur en scène lors de la prise de vues des images.
[45] Les Trois Mousquetaires, Gaumont-Pathé Archives, référence : 1921DOC 00312. https://gparchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=333331&rang=1.
[46] Henri DIAMANT-BERGER, Le Cinéma de grand-père. Mémoires d’Henri Diamant-Berger, Mémoires, p. 17. ©Jérôme Diamant-Berger. Je remercie Jérôme Diamant-Berger d’avoir fait circuler une version non éditée de ces Mémoires.
[48] « Le tournage de Vingt ans après », Gaumont-Pathé Archives, référence : CM 1731. https://gparchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=85695&rang=3.
[49] « Abel Gance tourne Napoléon », Gaumont-Pathé Archives, référence FRIGO 1. https://gparchives.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=75935&rang=26.
Résumé
Cet article analyse les premiers portraits cinématographiques de metteurs en scène de cinéma. Il repose sur un paradoxe, tant les sources sont rares : ceux-là mêmes qui filment leurs contemporains (artistes, écrivains, hommes politiques, etc.) sont souvent absents de l’écran, à quelques rares exceptions près. Les premiers portraits cinématographiques de ceux qui œuvrent derrière la caméra sont à chercher du côté du making of, du générique ou encore du portrait commercial, réservés à quelques rares personnalités. Évoluant au fil du temps, ces portraits fugitifs rendent compte du changement de perception du metteur en scène.
Abstract
This article aims to analyze the first animated French movie makers (called "metteurs en scène" in France). Due to very scarce resources, it is based on a paradox: with a few exceptions, the ones shooting movies of their contemporaries do not appear on the screen themselves. The first cinematographic portraits of those invisible movie makers can be found in making-of, opening and closing credits or even some commercial portraits restricted to very few celebrities. Changing over time, those fleeting portraits are a testimony of the change in perception of the metteur-en-scène.
L’Affairement au travail, l’appareillage technique
De l’esprit industriel à la lente émergence de l’art
Le metteur en scène en fiction
Mélissa GIGNAC
Université de Lille, Centre d’étude des arts contemporains
ALOVISIO Silvio, Voci del silenzio. La sceneggiatura nel cinema muto italiano, Milano, Il castoro, 2005.
BANU Georges, L’Homme de dos. Peinture, théâtre, Paris, Adam Biro, 2001.
BILLAUT Manon, « André Antoine au cinéma : une méthode expérimentale », thèse de doctorat en études cinématographiques, sous la direction de Laurent Véray, Université Paris 3, soutenue le 18 décembre 2017.
BILLAUT Manon, André Antoine au cinéma : une méthode expérimentale, Paris, éd. Mimésis, 2021.
Manon BILLAUT et Élodie TAMAYO, « André Antoine et Abel Gance : deux auteurs de film ? », dans Clément PUGET et Laurent VÉRAY (dir.), À la recherche de l’Histoire du cinéma en France (1908-1919) : lieux, sources, objets, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2022, p. 303-334.
B. G., « Le théâtre cinématographique », L’Illustration, n°3427, 31 octobre 1908, p. 285-289.
CAROU Alain, Le cinéma français et les écrivains : histoire d’une rencontre (1906-1914), Paris, École nationale des Chartes, A.F.R.H.C, 2002.
DELLUC Louis, Écrits cinématographiques I. Le cinéma et les cinéastes, Paris, Cinémathèque français, Éd. Pierre LHERMINIER, 1985.
DELLUC Louis, Écrits cinématographiques II. Cinéma & Cie, Paris, Cinémathèque française, éd. établie et présentée par Pierre LHERMINIER, 1986.
DIAMANT-BERGER Henri, « Scénarios, auteurs, éditeurs », Le Film, n°36, 18/11/1916, p.7.
DIAMANT-BERGER Henri, Le Cinéma de grand-père. Mémoires d’Henri Diamant-Berger, Mémoires. ©Jérôme DIAMANT-BERGER (s.d., référence incomplète).
FESCOURT Henri, La Foi et les montagnes ou le septième art au passé, Paris, Paul Montel, 1960.
GANCE Abel, « L’harmonie visuelle est devenue symphonie », conférence prononcée le 22 mars 1929, dans Pierre LHERMINIER, L’Art du cinéma, Paris, Seghers, 1960, p. 163-167.
GUY-BLACHÉ Alice, Autobiographie d’une pionnière du cinéma : 1873-1968, Paris, Denoël/Gonthier, 1976.
JASSET Victorin, « Étude sur la mise en scène », Ciné-Journal, n°165, le 21 octobre 1911, p.51.
IZOUARD Fernand, « Le cinématographe et le droit d’auteur », Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire, Art. 4727, 1908, p. 155-161.
La Gloire de Victor Hugo [Exposition, Paris, Grand Palais 1985/1986], Paris, Éd. de la réunion des musées nationaux, 1985.
LAVAUD Martine, Catalogue inédit de l’œuvre de Dornac (inclus dans le dossier d’HDR – garant Antoine Compagnon –présenté au Collège de France en juin 2018).
LE FORESTIER Laurent, Aux sources de l’industrie du cinéma : le modèle Pathé, 1905-1908, Paris, L’Harmattan, A.F.R.H.C., 2006.
« Lettres de Richard Cantinelli à Henri Lavedan », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze [En ligne], 56 | 2008, mis en ligne le 01 décembre 2011, consulté le 27 juin 2022. URL : http://journals.openedition.org/1895/4052 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1895.4052.
MAUGRAS Émile et GUÉGAN Maurice, Le Cinématographe devant le droit, Paris, V. Giard & E. Brière libraires-éditeurs, 1908.
QUILLET Chantal, MARTINEZ Jean-Luc (dir.), Figure d’artiste, [exposition, Paris, Musée du Louvre, Petite galerie, 25 septembre 2019-29 juin 2020], Paris, Seuil, Louvre éditions, 2019.
RIGAL Henry (enquête coordonnée par), « D’où vient cette crise de l’industrie cinématographique et quels problèmes soulève-t-elle ? », La Renaissance, politique, littéraire, artistique, n°19, septembre 1616, p. 16-21.
ROBERT Valentine, « Introduction. Fictions de création : la peinture en abyme et le cinéma en question », dans Laurent LE FORESTIER et Gilles MOUËLLIC (dir.), Filmer l’artiste au travail, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,2013, p. 9-28.
VIGNAUX Valérie (dir.), avec la collaboration de François ALBERA, Léon Moussinac : critique et théoricien des arts. Anthologie critique, Paris, A.F.R.H.C., 2014.
WRONA Adeline, Face au portrait, De Sainte-Beuve à Facebook, Paris, Hermann, 2015.