
Le 10 octobre 1991 trois membres du gang de Felice Maniero, boss mafieux de la Mala del Brenta, une association criminelle née dans la région de la Vénétie, rentrent armés dans la basilique de Saint Antoine à Padoue, en terrorisant les fidèles, pour voler une relique : un buste doré contenant le menton de S.Antoine (Fig. 1)1. Le vol avait pour but de faire pression sur les autorités afin de faire libérer le boss et son cousin, à la tête du trafic de drogue de la région entière2. Selon la version officielle le buste fut récupéré deux mois après dans les campagnes autour de l’aéroport de Fiumicino, près de Rome, mais, selon d’autres sources, on le fit retrouver non loin de la basilique de Saint-Antoine3. En 1994, le jour suivant à la fête du Saint, le 14 juin, un groupe d’hommes armés fait irruption dans la prison de Padoue et libère Felice Maniero4. La réaction de l’Etat italien sera très forte : le boss sera capturé quatre mois après sa fuite de prison, ainsi que les membres de son organisation criminelle, qui seront arrêtés grâce à la collaboration du chef de l’association, puisqu’il deviendra un collaborateur de justice en 1995, l’année des célébrations du huitième centenaire de la naissance de Saint Antoine (né à Lisbonne en 1195)5.

[Fig. 1]
Ce fait divers provoque beaucoup de bruit dans le Pays, surtout dans la région de la Vénétie, une réalité très présente dans les films de Mazzacurati. Le réalisateur padouan avec la collaboration des scénaristes : Bernini, Contarello et Pettenello s’inspirent donc de ce fait divers pour rédiger le scénario de La lingua del Santo6 (Fig. 2), film où il le réinterprète à travers sa poétique, qui vise à dénoncer et à mettre en relief les inégalités et les contradictions sociales de sa région. Comme dans d’autres films du même réalisateur, les protagonistes sont deux hommes obligés de vivre aux marges de la société et qui essaient de sortir de leur condition à travers un crime7. En mélangeant des éléments appartenant à la philosophie marxiste et d’autres appartenant à la commedia all’italiana, ainsi qu’à l’imaginaire du Décaméron8, La lingua del Santo met en scène l’histoire de Willy et Alberto (Fig. 3), deux hommes qui pour raisons différentes sont obligés de devenir des voleurs.
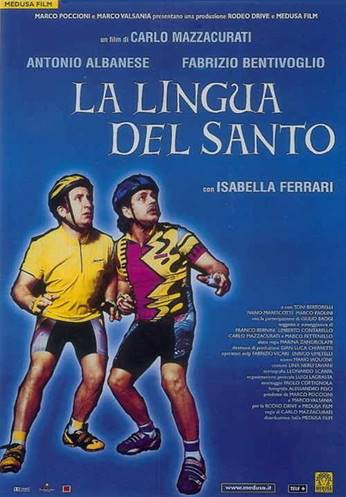
[Fig. 2]

[Fig. 3]
La voix off et le point de vue qui guident le spectateur à travers la réalité scénique appartiennent à Willy (Fig. 4), un ex représentant d’articles de papeterie, qui est né et a grandi dans la ville de Padoue9. Quitté par sa femme, qui lui préfère un chirurgien aisé, il ne réussit plus à vendre ses articles, et après quelques temps il n’arrive même plus à parler devant ses clients. Seul et sans ressources, Willy finit par se retrouver aux marges de la société padouane. Il devient client assidu d’un bar de la périphérie, peuplé par des exclus qui le surnomment Alain Delon, à cause de sa ressemblance avec l’acteur français. Habillé presque toujours avec le même costume, son ex tenue de représentant commercial, Willy revit toujours le trauma lié à l’exclusion du corps social de sa ville d’appartenance : « Ma ville. C’est l’un des endroits les plus riches du monde, elle génère autant de chiffres d’affaires que le Portugal tout entier, mais si tu n’as pas d’argent, il n’y a aucune pitié »10, dit sa voix off rauque et triste.

[Fig. 4]
Antonio, qui à la différence de son ami ne vient pas de la ville de Padoue, n’a pas pu s’intégrer dans le tissu social et économique de la ville. Sa seule passion est le rugby, sport représenté dans le film comme métaphore de la vie, avec la seule différence que sur le terrain de rugby les règles sont claires, comme le soutient Antonio. Si le personnage est aux marges de la société, seul et exclu des circuits du travail, il l’est aussi (par conséquent) sur le terrain de rugby. N’arrivant plus à courir, il est toujours sur la touche et il ne rentre sur le terrain que pour réaliser les essais quand il y a un tir au but à tirer. Sa désillusion est mise en évidence même dans ce contexte, puisqu’il n’accepte de tirer que sous le payement de 50 000 Lires pour chaque tir réussi. Son existence, privée de toute forme de planification, vise à satisfaire les pulsions les plus basiques, liées à l’alimentation et à la sphère sexuelle. La dimension corporelle est donc très importante dans le personnage d’Antonio. Il n’est pas encadré par le système normatif du pouvoir11 de la réalité sociale padouane et sa poussée vers la satisfaction imminente des pulsions possède des caractéristiques anarchistes. Le corps d’Antonio met en scène une sorte d’anarchisme pasolinien lié aux pulsions, qu’on peut retrouver par exemple dans Ragazzi di vita12.
Dans la bande annonce du film il est déjà possible de constater la mise en relation de l’espace sacré et de l’espace profane. Dans l’un des premiers cadrages montrant le match de rugby de l’équipe d’Antonio, l’église de Santa Giustina domine la scène par sa grandeur, pendant que les joueurs se préparent à la mêlée (Fig. 5). Structure religieuse et structure sociale sont mises en confrontation et par certains aspects en opposition. À l’harmonie de l’édifice religieux, qui mélange lignes courbes (coupoles, rosaces, absides) et lignes droites (nefs et tympans), en unissant architecture médiévale et architecture de la Renaissance, s’oppose la confusion du match. À la grandeur de la basilique s’opposent les petites dimensions des joueurs. Mais malgré cette évidente disproportion, l’édifice religieux n’est que le décor du match. Personne ne le regarde, personne ne semble s’apercevoir de sa présence, car chaque regard est dirigé vers le bas, vers la mêlée, symbole des dynamiques sociales. L’espace de l’église de Santa Giustina englobe toutefois tous les joueurs. Ce qui anticipe ce que le réalisateur mettra en scène de façon plus détaillée à la fin du premier acte du film : l’espace sacré est l’espace de la vie, ce qui reprend la conception romane de la cathédrale. Comme l’affirme l’historien de l’art Giulio Carlo Argan, le roman conçoit l’espace sacré comme :
image vivante du système. Elle est vivante parce que, en plus d’être un lieu de culte, elle est aussi basilique dans le sens romain, c’est-à-dire le lieu où la communauté se rassemble pour participer aux conseils, où parfois on fait des affaires. […] La cathédrale est l’espace de la vie, où chaque chose trouve sa raison d’être13.

[Fig. 5]
C’était particulièrement évident dans les communes du centre et du nord de l’Italie, qui bénéficiaient d’une autonomie très forte et où la vie citoyenne était très active14. La mêlée de la vie et de la société, pour reprendre la métaphore présente dans le film, trouve donc sa place dans la conception romane de la cathédrale et plus généralement, comme l’affirme toujours Argan, de l’église15.
N’étant pas capables de mettre en place des vols bien organisés, les deux protagonistes se résolvent à voler des objets assez simples : de vieux ordinateurs dans une école primaire, des stylos dans une papèterie, une carcasse de bœuf dans une boucherie. Pendant ce dernier vol Willy et Antonio sont vus par un agent de police et, afin de lui échapper, ils rejoignent la procession en honneur de saint Antoine, en arrivant ainsi à se réfugier dans la basilique homonyme. Dès que l’office est terminé et que tous les fidèles ont quitté l’église, Willy et Antonio essaient de voler l’argent des dons mais, à cause du bruit, ils attirent l’attention de deux pitbulls. Pendant la fuite, Antonio se trouve par hasard devant le buste contenant la langue de saint Antoine et décide de le voler.
Les séances qui vont du vol de la carcasse de bœuf (min. 10 :22) à la fuite des deux personnages de la basilique (min. 15 :16) nous guident vers la fin du premier acte16. Leur début reprend une scène amusante de I soliti ignoti de Mario Monicelli (titre traduit en français par Le pigeon), un classique du cinéma italien, sorti en 1958. Le film se termine en montrant les protagonistes qui, pour échapper à la police se cachent au milieu d’un groupe de travailleurs se tenant devant un chantier (Fig. 6). Étant de très mauvais voleurs, ils sont obligés d’aller travailler, poussés par la masse des ouvriers et malgré leur résistance. Dans le film de Mazzacurati, en revanche, la dynamique est exactement inversée : les deux protagonistes, exclus du monde du travail, sont obligés de devenir voleurs et, pour échapper à la police, ils se cachent parmi les fidèles de la procession de Saint-Antoine (Fig. 7). Si les deux personnages de Monicelli sont poussés par la masse vers le travail et la norme, Willy et Antonio sont conduit par la procession vers la basilique, où ils voleront une relique. Le film est donc clairement en continuité avec l’œuvre de Monicelli. Si I soliti ignoti représente le début du miracle économique italien, grâce auquel le Pays deviendra en une dizaine d’années l’une des nations les plus riches du monde, La Lingua del Santo met en scène le point d’arrivée de la société capitaliste de la Terza Italia, qui a ses racines dans le miracle économique de l’après-guerre. La définition de Terza Italia est utilisée pour la première fois en 1977 par Arnaldo Bagnasco17. À la dichotomie traditionnelle Nord-Sud, le sociologue oppose un modèle économique qui divise l’Italie en trois parties. La Terza Italia, qui correspond aux régions du centre du Pays, sauf le Latium, et du nord est, présente un tissu économique basé sur un important réseau de petites et moyennes entreprises. Cette structure économique a créé dans la Vénétie une suprastructure culturelle qui met au centre la richesse, la production, le stakhanovisme et l’individualisme, considérés comme valeurs fondamentales de la société. Comme on peut le voir dans La lingua del Santo, ainsi que dans d’autres films du même réalisateur, Mazzacurati critique de façon très forte cette mentalité, en la présentant comme source d’injustice et de marginalisation. Revenons à la séquence filmique pour constater que l’espace de la basilique, s’il constitue pour les fidèles un espace sacré lié aux rituels religieux (Fig. 8), il apparaît pour les deux protagonistes comme espace profane, où se cacher pour ne pas être rejoints par le policier qui les poursuit (Fig. 9). Afin de mieux analyser le film et en particulier la séance qui se déroule à l’intérieur de la basilique, il est utile de reprendre le modèle à trois niveaux proposés par l’anthropologue François Gauthier, pour expliquer les faits religieux18. Le premier niveau est constitué par le religieux, c’est-à-dire la façon dont le corps social conçoit son rapport avec l’altérité, notamment avec : l’origine, l’infini et l’éternel. Le deuxième niveau est celui de la religion, qui concerne « les formes religieuses variablement autonomisées et institutionalisées dans une société donnée à une époque donnée »19. Le dernier niveau est celui de la religiosité, qui « se réfère au religieux vécu, c’est-à dire aux appropriations personnelles, aux comportements, aux significations subjectives et aux dimensions expérientielles de la religion »20. Au niveau de la religion représenté dans le film à travers les rituels institutionalisés que les fidèles accomplissent, s’oppose celui des actes profanes d’Antonio et Willy, lesquels les amèneront à développer une forme particulière de leur religiosité. À la répétitivité des gestes des fidèles et des pratiques religieuses institutionalisées s’oppose une forme de religiosité et du rapport avec la divinité qui se présente de façon dynamique. Tout passe toutefois à travers le rapport qui s’établit avec le corps de Saint-Antoine, dont l’espace de la basilique est la représentation, ainsi que l’écrit Joëlle Prungnaud :
Si la cathédrale est le « miroir de la nature », elle est aussi pour l’homme un lieu où il se projette corps et âme. Par un phénomène d’identification, il tend à reconnaître, dans le dessin général de la configuration architecturale, des formes corporelles et attribue à l’édifice un esprit et un langage […] À la différence du corps mystique symbolisé par l’architecture cruciforme, ou du corps érotique fantasmatiquement projeté sur les formes plastiques, la relique appartient au corps organique. Elle est de la même nature que les défunts inhumés sous les dalles21.

[Fig. 6]

[Fig. 7]

[Fig. 8]

[Fig. 9]
Dans l’imaginaire padouan, par ailleurs, saint Antoine et la basilique qui porte son nom et contient ses reliques sont assimilés22. Les habitants de la ville vénitienne en fait appellent très souvent la basilique en question « il Santo », c’est-à-dire « le Saint », en utilisant une métonymie qui parvient à faire coïncider la divinité avec le lieu de culte. Comme on peut le constater dans la séance qui se déroule à l’intérieur de l’espace sacré, le corps social d’un côté et le corps religieux de l’autre entrent en relation par des rituels et des pratiques codifiés et notamment à travers le contact physique.
Une fois que l’office est terminé, la basilique change totalement d’aspect et se vide de ses fidèles (Fig. 10). Si dans les cadrages précédents l’espace sacré était représenté en relation avec les fidèles et « emprisonné » dans le cadre de la religion, après la fonction il se présente aux spectateurs grâce à un plan large qui montre une bonne partie de l’espace et son articulation. La religion, la contemplation, est maintenant remplacée par des actes de profanation. À la dévotion exprimée par des gestes tactiles, visant à mettre en relation le corps du saint et le corps social, se substituent des actes violents, nés des contradictions et des injustices présentes au sein de la société. L’acte blasphématoire, violent, accompli contre l’espace sacré et donc sur le corps de saint Antoine reporte la basilique romane à être espace de la vie. L’organisme basilique se démontre très fonctionnel et permet de réaliser le but que le saint s’était préfixé, comme le suggère le plan moyen23 de la statue de saint Antoine. La tentative de voler l’argent des donations attire l’attention de deux chiens, qui, en poursuivant Antonio et Willy, les obligent à se diriger vers les échafaudages. La présence de deux pitbulls dans la basilique est certainement assez étrange et fait penser à une intervention divine, notamment si on la met en relation avec le mouvement de caméra qui pendant quelques secondes arrête de suivre les protagonistes pour se focaliser sur la statue du saint (Fig. 11-12). Antonio et Willy sont donc poussés vers les échafaudages et obligés de les monter, ce qui mène Antonio à la thèque contenant la relique. Comme on peut le constater par la position de la caméra, se situant derrière le buste, c’est ce dernier qui semble regarder le personnage, pour qu’il le vole et non pas l’inverse (Fig. 13). Le cadrage suivant, au lieu de nous monter un contrechamp classique, consiste en un plan à l’italienne encadrant la partie postérieure d’Antonio, comme si ses actions étaient guidées par une force extérieure (Fig. 14). Les échafaudages permettent ensuite aux personnages d’arriver jusqu’au toit de la basilique pour ensuite descendre grâce aux divers dénivelés de l’architecture. Le rapport avec l’espace sacré reste donc marqué par le contact physique (Fig. 15), un contact qui, à la différence de celui des fidèles se configure par des dynamiques utilitaristes et très concrètes, en mettant encore une fois en évidence comment espace sacré et espace du monde en viennent à coïncider dans la représentation faite par Mazzacurati. L’édifice religieux, cadré jusqu’à présent seulement de l’intérieur, montre, après la sortie des deux voleurs, son extérieur aux spectateurs : une partie de sa façade et deux coupoles en restructuration. La statue de Gattamelata, sculptée par Donatello (Fig. 16), représentant un condottiere du Moyen Âge et symbole des pouvoirs institutionnels, s’élève devant elle. Cette opposition préfigure les vicissitudes que les deux protagonistes affronteront.

[Fig. 10]

[Fig. 11]

[Fig. 12]

[Fig. 13]

[Fig. 14]

[Fig. 15]

[Fig. 16]
Willy, étant padouan, à la différence de son ami comprend l’acte horriblement blasphématoire qu’ils ont accompli. Dans un premier temps il veut rendre la relique. Toutefois, en retournant en ville et en croyant être presque invisible aux yeux de la police, il en vient à penser que c’était saint Antoine lui-même, en tant que protecteur des marginalisés, qui les a poussés à voler sa langue pour qu’Antonio lui puissent enfin prendre leur revanche sur toutes les injustices subies. De telle sorte que Willy se sente en osmose avec le saint, en pensant accomplir sa volonté. Tout arrive à se configurer de façon très claire dans la pensée de Willy, en s’organisant à l’intérieur de paradigmes concernant la religiosité individuelle, laquelle, dans ce contexte, s’oppose aux pratiques institutionalisées de la religion. Cette illumination amène le personnage à changer de statut à l’intérieur de l’intrigue, devenant aussi mentor et non plus héros24. À partir de ce moment il s’occupera de mettre en place un plan finalisé à obtenir une riche rançon pour la restitution de la relique. Cela permettra aux deux personnages de sortir de leur condition de marginalisation, en pouvant enfin être écoutés. La langue volée devient donc, à travers ce procédé, leur langue, puisqu’elle leur permet de faire entendre leurs voix aux autorités et à la société padouane.
Bientôt les deux protagonistes, pour mieux mettre en place leur plan, se déplacent vers les Collines Euganéennes. Après plusieurs jours d’attente, ils voient passer sur une chaine locale le message d’Alvaro Maritan, un entrepreneur de la région se disant disposé à payer la rançon pour la restitution de la langue. La vidéo, plus qu’un appel aux voleurs, a toutes les caractéristiques d’un spot publicitaire. L’entrepreneur incarne toutes les valeurs sociales caractéristiques de sa région. Sa façon de parler vide la relique de toute dimension transcendantale, pour l’envisager en termes de possession. Le personnage exprime le sentiment religieux dominant, incapable de voir au-delà des dynamiques d’appartenance et de possession, et le sentiment religieux dont il est porteur ne semble pas être très distant des valeurs du marché. À cette conception du religieux s’oppose la religiosité de Willy, qui voit la divinité dans le quotidien et dans la nature. Ce faisant, le personnage reprend certains principes de l’ordre franciscain25, dont saint Antoine faisait partie.
Après la fuite de Willy et Antonio sur les collines Euganéennes avec la relique, l’espace naturel se configure comme espace sacré. Il est en même temps refuge et source d’approvisionnement pour les deux personnages, puisque l’aide du saint se manifeste à travers des éléments naturels qui les secourent lors des situations difficiles. Le premier « événement miraculeux » concerne la découverte d’une champignonnière après des jours de jeûne, dus aux difficultés à repérer de la nourriture, alors que le second a lieu pendant la nuit de la première tentative d’échanger la relique avec la rançon et se manifeste à travers la présence d’une pleine lune très lumineuse, permettant à Willy et Antonio de s’apercevoir à temps de l’arrivée de la police, et de parvenir ainsi à s’échapper. Si la première partie du film met en évidence le rapport entre corps individuel, corps social et corps sacré, la seconde se focalise sur la stricte relation qui s’instaure entre le corps individuel, marqué par ses instincts, et le corps naturel, incarnation du corps de la divinité. La relation entre les deux entités se configure à travers des dynamiques de forte connexion qui rejettent toute forme d’opposition, comme en témoigne l’incapacité des deux protagonistes de tuer un poulet pour se nourrir. Dans le final, grâce à sa connaissance de la lagune vénitienne et de ses marées, et donc grâce à sa connexion avec les éléments naturels, Willy arrive à effectuer l’échange. Il décide toutefois de laisser le milliard de Lire de la rançon à son ami Antonio, qui s’embarque clandestinement sur un avion. Willy décide enfin de se rendre à la police. Malgré tout il se sent partie de sa ville et dit de ne pas pouvoir la quitter. Enfin, il peut être vu, reconnu par ses concitoyens.
La séquence finale présente les images tournées en 1995, lors du retour de la relique dans la basilique après le vol de la Mala del Brenta. Il est intéressant de constater que ce ne sont pas les autorités religieuses qui la rapportent dans la basilique mais deux gendarmes (Fig. 17). La scène se lie à l’une des scènes précédentes, où Willy se trouve sur un bateau de la police avec des policiers qui l’emmèneront à la prison (Fig. 18). Le corps du saint, tout comme celui de Willy sera emprisonné. Sa prison ne sera pas physique mais conceptuelle, s’exprimant sous forme d’une conception religieuse qui l’emprisonne dans une dimension hors du monde naturel et du quotidien (Fig. 19). La chanson Guantanamera, liée aux mouvements d’indépendance de Cuba, qui accompagne les images se présente donc comme un cri en opposition au rétablissement d’un ordre perçu comme injuste et porteur d’inégalités.
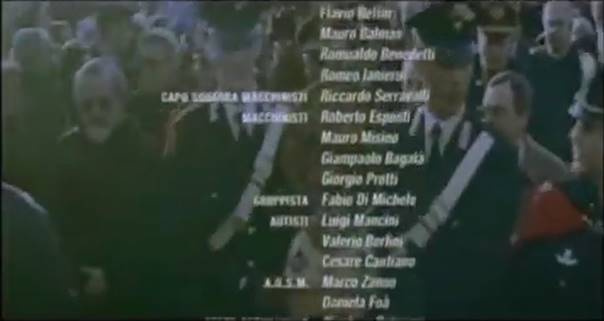
[Fig. 17]

[Fig. 18]
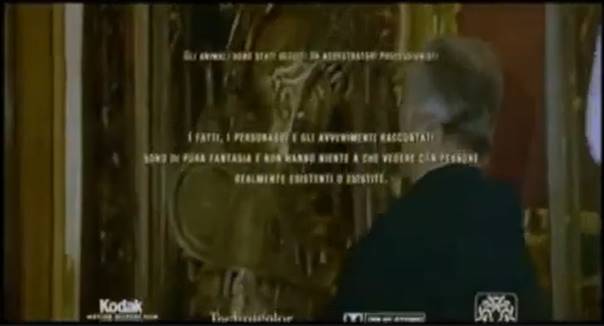
[Fig. 19]
[1] Luciano MORBIATO, La lingua del Santo, in Antonio COSTA (dir.) Carlo Mazzacurati, Venice, Marsilio, 2015, p. 130-146
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Nous nous référons notamment à Il toro (1994) et Vesna va veloce (1996)
[8] Cfr. L. MORBIATO, op. cit.
[9] Ci-dessous la description faite par la voix off de Willy de sa propre condition existentielle et celle d’Antonio : « On était nés dans des familles honnêtes, nous, et nous avions grandi comme des personnes honnêtes mais après les circonstances de la vie nous avaient emmenés sur ce chemin. Moi, jusqu’il y a deux ans, j’étais un représentant d’articles de luxe de papeterie. J’avais aussi un certain succès. Je me présentais bien, les clients disaient que j’avais une belle manière de parler, j’étais toujours habillé en costume Elles sont belles les cravates, elles te font sentir à l’aise. C’est bizarre où le destin t’emmène parfois : c’était moi qui avais vendu ces stylos la dernière fois que j’étais rentré dans ce magasin. Evidemment ils n’avaient pas eu beaucoup de succès. Ensemble on était vraiment une belle équipe. On n’avait pas de grandes exigences, on ne volait que quand c’était nécessaire. Mais désormais c’était devenu toujours nécessaire. Antonio jouait au rugby depuis qu’il avait 20 ans. Il aimait ce sport, il disait qu’au moins là-bas les règles étaient claires. Dans la vie, en revanche, il n’arrivait à trouver ni une place, ni un rôle. Ses parents venaient d’une autre ville et quand ils étaient morts, personne dans toute la ville ne lui avait donné un coup de main. Il s’était retrouvé tout seul dans la mêlée et il avait fait des petits métiers : électricien, peintre… mais ça ne durait jamais plus d’une semaine. Et à la fin son travail était devenu : éviter de travailler » Nous traduisons
[10] Nous traduisons.
[11] Cfr. Michel FOUCAULT, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975 ; Michel FOUCAULT, Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976.
[12] Cfr. L. MORBIATO, op. cit. Cfr. Myriam SWENN, « Il realismo poetico di Pier Paolo Pasolini : Ragazzi di vita », Carte Italiane, 1 (4), 1983, URL : https://escholarship.org/uc/item/9m59s9w5.
[13] Giulio Carlo ARGAN, Storia dell’arte italiana. Il Medioevo, Sansoni Editore, 2000. Texte original : « immagine vivente del sistema. È vivente perché, oltre al luogo del culto, è anche basilica nel senso romano, dove la comunità si aduna a consiglio, dove ogni tanto si trattano affari. […] La cattedrale è lo spazio della vita, dove ogni cosa trova la sua ragion d’essere ». Nous traduisons p. 62.
[14] Cfr. Massimo MONTANARI, Storia medievale, Bari, Laterza, 2002.
[16] Cristopher VOGLER, Il viaggio dell’eroe, trad. it. J. LORETI, Rome, Dino Audino Editore, 2010. Titre original : The writer’s journey.
[17] Arnaldo BAGNASCO, Tre Italie, Bologne, Il Mulino, 1977.
[18] François GAUTIER, « Religieux, religion, religiosité », Revue du Mauss, n°49, 2017/1, p. 167-184. URL : https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2017-1-page-167.htm?ref=doi.
[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Joëlle PRUNGNAUD, Figures littéraires de la cathédrale 1880-1918, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2008, p. 167.
[22] L’association entre le saint et la basilique et mise notamment en évidence dans un rêve qu’Antonio fait après avoir volé la relique, où Saint-Antoine lui apparait en essayant de lui parler. Le Saint rencontre toutefois des difficultés à s’exprimer, puisqu’il est privé de sa langue (min. 1 :24 :03 – min. 1 :26 :10)
[23] En ce qui concerne le langage filmique, nous faisons référence à : Arcangelo MAZZOLENI, L’ABC del linguaggio cinematografico. Strutture, analisi e figure nella narrazione per immagini, Rome, Dino Audino Editore, 2002.
[24] C. VOGLER, op. cit.
[25] Cfr. Jacques LE GOFF, St François d’Assise, Paris, Gallimard, 2014. « Mi-religieux, mi-laïc, dans les villes en plein essor, sur les routes et dans la retraite solitaire, dans la floraison de la civilisation courtoise se combinant avec une nouvelle pratique de la pauvreté, de l’humilité et de la parole, aux marges de l’Eglise mais sans tomber dans l’hérésie, révolté sans nihilisme, actif dans ce lieu le plus bouillonnant de la Chrétienté, l’Italie centrale, entre Rome et la solitude de la Verne, François a joué un rôle décisif dans l’essor des nouveaux ordres Mendiants diffusant un apostolat pour la nouvelle société chrétienne d’une dimension écologique, au point d’apparaitre l’inventeur d’un sentiment médiéval de la nature, s’exprimant dans la religion, la littérature et l’art », p. 3.
Résumé
Cet article se propose d’analyser la représentation de la basilique de Saint Antoine de Padoue et l’espace sacré dans le film La lingua del Santo de Carlo Mazzacurati (2000). Pour ce faire nous utiliserons des concepts appartenant en particulier à l’analyse filmique et à l’anthropologie (notamment les concepts de : religieux, religion et religiosité), en mettant l’œuvre de Mazzacurati en relation avec les caractéristiques du tissu économique et social de la ville de Padoue. Notre analyse se focalisera principalement sur l’interaction entre espace sacré, conçu comme corps, et individu, en montrant que la relation avec ce dernier reprend la conception de la cathédrale romane, ainsi que la doctrine franciscaine.
Riassunto
L’articolo si propone di analizzare la rappresentazione della basilica di Sant’Antonio da Padova e dello spazio sacro nel film La lingua del Santo di Carlo Mazzacurati (2000). Per farlo si utilizzeranno dei concetti appartenenti in particolare all’analisi filmica e all’antropologia (principalmente i concetti di: religioso, religione e religiosità), mettendo l’opera di Mazzacurati in relazione con le caratteristiche del tessuto economico-sociale della realtà padovana. L’analisi effettuata si focalizzerà principalmente sull’interazione tra spazio sacro, concepito come corpo, e individui, mettendo in evidenza come la relazione con quest’ultimo riprenda la concezione della cattedrale romanica, così come quella della dottrina francescana.
Francesco RIZZO
Sorbonne Université ; Università degli studi di Roma – La Sapienza, LASLAR ; ELCI
ARGAN, Giulio Carlo, Storia dell’arte italiana. Il Medioevo, Sansoni Editore, 2000.
BAGNASCO, Arnaldo, Tre Italie, Bologne, Il Mulino, 1977.
COSTA, Antonio (dir.), Carlo Mazzacurati, Venice, Marsilio, 2015.
FOUCAULT, Michel, Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976.
─, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975.
GAUTIER, François, « Religieux, religion, religiosité » in Revue du Mauss, n°49, 2017/1, p. 167-184. URL : https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2017-1-page-167.htm?ref=doi.
LE GOFF, Jacques, St François d’Assise, Paris, Gallimard, 2014.
MAZZOLENI, Arcangelo, L’ABC del linguaggio cinematografico. Strutture, analisi e figure nella narrazione per immagini, Rome, Dino Audino Editore, 2002.
MONTANARI, Massimo, Storia medievale, Bari, Laterza, 2002.
PRUNGNAUD, Joëlle, Figures littéraires de la cathédrale 1880-1918, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2008.
SWENN, Myriam, « Il realismo poetico di Pier Paolo Pasolini : Ragazzi di vita », Carte Italiane, 1 (4), 1983, URL : https://escholarship.org/uc/item/9m59s9w5
VOGLER, Cristopher, Il viaggio dell’eroe, trad. it. J. LORETI, Rome, Dino Audino Editore, 2010. Titre original : The writer’s journey.
Filmographie
MAZZACURATI, Carlo, La lingua del Santo, 2000.
─, Il toro, 1994.
─, Vesna va veloce, 1996.
MONICELLI, Mario, I soliti ignoti, 1958.