
Curieusement, la thématique muséale dans l’œuvre romanesques de Jean-Philippe Toussaint n’a guère fait l’objet de travaux si ce n’est, quasi exclusivement1, sous la forme et sous l’angle d’expositions auxquelles l’écrivain-plasticien a participé. Pourtant, les « musées » des beaux-arts et d’art contemporain essaiment dans l’œuvre de l’écrivain, qu’ils soient évoqués incidemment sous la forme d’une analogie apparemment anodine pour décrire, ici de façon satirique, dans La Salle de bain, l’attitude stéréotypée du visiteur de musée : « Nous faisions le tour des chambres de la manière dont on visite un musée, les mains derrière le dos, avec un détachement intéressé2. », là, avec affection, un pittoresque lit de bébé aux allures de « petit Centre Pompidou » dans La Réticence :
J’avais installé le lit de voyage de mon fils près de moi dans la chambre, un petit lit pliant assez pratique qui consistait en un assemblage de tubes métalliques de différentes couleurs qui s’emboîtaient les uns dans les autres pour composer un châssis rectangulaire, sorte de petit centre Georges-Pompidou qui se dressait là dans la pénombre de la pièce à côté de mes sacs et de mes valises3.
Mais pensons au malheureux jeu de cache-cache qui s’achève sur une rupture dans Faire l’amour4 : le narrateur cherche sa compagne, insaisissable dans les méandres d’un musée où elle expose ses œuvres. Le musée est-il un simple décor dans ces scènes ? N’est-il pas un actant pour ainsi dire, complice tantôt de Marie, tantôt du narrateur ?
C’est que le musée toussaintien se dit moins dans l’évocation, ni même dans la description méticuleuse de salles d’exposition, que dans un imaginaire polymorphe qui relève de divers lieux et, surtout, de différents motifs. Le musée est un conservatoire d’images et de souvenirs, et un laboratoire – un lieu d’expériences, voire d’expérimentations en tout genre. À partir d’une étude des représentations des musées figurant dans l’œuvre romanesque de Toussaint5, l’analyse montrera que celles-ci s’aimantent amoureusement autour du musée, tour à tour fui et recherché. Si le musée est cet espace où s’exposent des œuvres d’art, il serait surtout le lieu métonymique où l’art de Marie (artiste, compagne du narrateur et protagoniste d’un cycle romanesque), de Toussaint, où l’écriture s’exposent, à des niveaux différents, en train de s’élaborer, où sont mis à nus les mécanismes de création, où se révèlent à eux-mêmes l’écriture, l’art, la pensée et l’identité du narrateur et de l’auteur au sens photographique et épiphanique du terme. On s’intéressera ainsi tout particulièrement au motif de la chambre noire qui sous-tend la manière dont l’auteur conçoit et figure le musée et qui informe en retour la matière romanesque6 : le musée est un monde qui se définit par des motifs à caractère visuel (contrastes de couleurs, jeux de luminosité, mise en abyme d’écrans et de cadres, architectures). Espace privilégié des pulsions scopiques du narrateur, le musée constitue un dispositif optique complexe pour observer et comprendre le réel plus largement7. Les interrogations de Toussaint sur les techniques de l’image et les moyens de communication contemporains (télévision, portable, photographie)8 convergent en effet autour de lui dans une réflexion diachronique et synchronique pour mettre en abyme la manière dont l’écriture romanesque expose et révèle le sujet et le monde à lui-même.
Les musées de Jean-Philippe Toussaint sont des musées réels, à la différence des hôtels fictifs, évoqués dans L’Urgence et la Patience9. Ce sont plus particulièrement des musées d’art autour desquels se retrouvent des personnages de musée, familiers de l’institution parce qu’historien de l’art10, artiste (cycle de Marie) ou écrivain-plasticien (Toussaint lui-même).
Or, plutôt que d’être figurés comme des lieux où l’art s’expose passivement au visiteur, ou comme des sanctuaires mortifères où l’art se momifie selon un imaginaire éculé11 qui a nourri et nourrit encore la critique de l’institution, ces musées sont le décor d’une énigme, d’une quête et d’une enquête dynamiques, actives, souvent inconfortables :
[C]’était étrange et même un peu douloureux […]. / Je quittai la salle de contrôle en vacillant, j’avais la tête qui tournait. Mes yeux piquaient d’avoir fixé l’écran si intensément et ma vue se brouillait sous des éblouissements blancs […] »12.
De fait, il arrive que les musées toussaintiens grouillent de bruits et d’images, de visiteurs et de personnels qui donnent le vertige. Plusieurs passages de Nue en témoignent :
Il régnait une grande animation lorsque je débouchai sur le parking de l’hôtel de luxe qui jouxtait le Contemporary Art Space de Shinagawa. Une multitude de taxis arrivaient et déchargeaient des clients qui se rendaient à l’exposition […]13.
Ou encore cet extrait : « Des bribes de conversation en toutes langues parvenaient à mes oreilles […]14. », et cet autre : « Le grand hall de marbre noir du musée grouillait de monde […]. [O]n ne percevait aucun détail précis, seulement un grouillement continu de foule indifférenciée […]15 ».
Le narrateur (pas plus que Jean-Philippe Toussaint !) n’ignore que le musée reste un espace de tradition où les corps et les esprits sont corsetés par des usages qui ont la vie dure. De prime abord, le musée dans Nue a des allures symptomatiques de forteresse :
Pour accéder à l’entrée du musée, il fallait longer un mur d’enceinte en grosses pierres sur une centaine de mètres. […] / L’allée, peu éclairée, continuait de s’enfoncer dans les sous-bois, on devinait les ombres effilées des arbres qui descendaient en pente douce vers un petit lac. À mesure que nous nous enfoncions dans le noir, le bruit des conversations s’atténuait […]16.
Usages figés aussi parce que le musée est le cadre de mondanités hypocrites, à l’image de la scène de vernissage dans Nue17. Quant aux visiteurs avisés, ils s’apparentent à des gardiens en « tournée d’inspection18 ». Pierre Signorelli, par exemple, scrute et évalue les œuvres avec majesté là où le portent « nonchalamment19 » ses pas :
Pendant ce temps, Pierre Signorelli […] déambulait majestueusement dans l’exposition, les mains derrière le dos […], comme s’il faisait une tournée d’inspection dans une demeure privée, jetant à l’occasion un regard critique et mesuré sur les œuvres exposées sur les cimaises […]20.
Ce personnage sert à figurer les habitudes confortables du visiteur type, croqué de façon satirique à plusieurs reprises sous les traits du cuistre rêveur qu’un Daumier s’est amusé à caricaturer en son temps. Car, la plupart du temps chez Toussaint, le musée des beaux-arts est un temple silencieux où règne en maître un silence sacré, où il est interdit de toucher les œuvres : «[J]e me penchais de nouveau sur la toile, le gardien s’avança soudain vers moi à grands pas en hurlant de m’éloigner du tableau »21.
Les gardiens de salle ne sont pas les seuls à jouer les garants d’un certain savoir-vivre : le narrateur s’expose aussi au regard réprobateur du visiteur de bon aloi pour un sandwich inopportun :
[U]n homme entra, à pas lents […]. [I]l regarda un instant [le portrait], les mains derrière le dos, puis, passant au tableau suivant avec beaucoup d’aisance […], il s’arrêta devant le plus grand des Dürer […]. L’homme, sceptique, après avoir encore une fois regardé le sandwich et avoir relevé une dernière fois les yeux sur moi, quitta la salle en silence […]22.
Voilà autant de codes qui caractérisent les musées, espaces qui cadrent et encadrent le regard, le corps, l’esprit.

Figure 1 : Honoré Daumier, « Mr
Prudhomme visitant les ateliers à l’approche de l’exposition de peinture »/3,
série « Ces bons Parisiens », lithographique,
1855-1858, Le Charivari, http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/mr-prudhomme-visitant-les-ateliers-a-l-approche-de-l-exposition-de-peinture#infos-principales
Les musées sont également des espaces étouffants car saturés de sens, comme la télévision sature le cerveau de stimuli23. Ils sont des espaces où le passé et ses traces sont conservés, ordonnés et exposés. Ils suscitent la remémoration et la commémoration de morceaux de vie affleurant la conscience du personnage à mesure qu’il déambule, puis par sa retranscription aux côtés d’œuvres endormies, telles ces « statues grecques immobiles depuis des millénaires24 », dans Fuir. Le narrateur de La Télévision le remarque d’ailleurs : « [J]’avais croisé en entrant quelques-unes de ces beautés pré-colombiennes qui sommeillaient dans les vitrines […] »25.
C’est qu’au musée, la recherche du sens de l’art, la quête introspective de soi, la quête rétrospective d’une relation amoureuse et la méditation métaphysique ne font qu’un. Elles se déploient et s’entrecroisent comme nulle part ailleurs. « Cosa mentale26 », l’art mais aussi les artistes sont une chose complexe et obscure dont toute l’œuvre de Toussaint cherche à percer à jour les secrets. Le musée constitue donc un enjeu herméneutique de première importance : il est le lieu d’une enquête à laquelle s’emploient les narrateurs, tous aimantés par des musées où ils tentent de trouver des réponses à ces questions : qu’est-ce que l’art ? Qu’est-ce que et comment créer ? Pourquoi ? Pour qui ? Qu’est-ce qu’être artiste ? Mais aussi qu’est-ce qu’une image ? Qu’est-ce qu’un musée ? À coup sûr, il ne s’agit pas pour Jean-Philippe Toussaint d’une institution ronronnante, mais d’un lieu de vie et d’interrogation de et sur l’art, d’un lieu à investir de façon décalée.
C’est sans doute dans La Télévision que se trouve explicitée le plus clairement l’intrigue de l’enquête dont font l’objet des œuvres de musée et, partant, le musée en soi, parallèlement à une quête existentielle que cristallise l’abandon de la télévision pour le narrateur. Dans ce roman, l’historien de l’art est chez lui au musée et à la bibliothèque, qualifiés de « retraite »27. Il dit y méditer « paisiblement »28 et emploie d’ailleurs systématiquement cet adverbe pour traduire son épanouissement au musée. Dans une savante et comique mise en abyme de l’écriture du roman, le seiziémiste raconte comment il essaie d’écrire une étude sur Titien. L’enquête historique à laquelle se prête le personnage le conduit de façon symptomatique à mener ses recherches dans une bibliothèque et dans un musée : la Bibliothèque publique d’information, associée au musée du Centre Pompidou, et le musée berlinois de Dahlem :
Au bas des lents escaliers mécaniques qui mènent à l’étage inférieur de la bibliothèque de Beaubourg, sur lesquels je me laissais descendre (je vivais à Paris à ce moment-là), immobile et pensif, les bras croisés, jouissant paisiblement de la superbe vue plongeante sur l’immense salle de lecture où des centaines de personnes se consacraient paisiblement à l’étude, je m’étais dirigé vers le département de peinture de la bibliothèque […]29.
Dans le cycle de Marie, le musée est doté, comme la femme aimée, d’une « disposition océanique »30 : à l’image de la désunion dont il est le cadre, le musée est de nature dysphorique. Cette équation intime entre le musée, le narrateur et Marie pointait déjà dans le surnom que le narrateur donne à Marie en référence à un musée new-yorkais et à ses expositions : « MoMA », anagramme chaotique construit sur les initiales de son nom : « Marie s’appelait de Montalte, Marie de Montalte, Marie Madeleine Marguerite de Montalte […]. [S]es amis et collaborateurs la surnommaient Mamo, que j’avais transformé en MoMA au moment de ses premières expositions d’art contemporain »31.
Ainsi, dans Faire l’amour, le Hara Museum of Contemporary Art de Shinagawa devient l’épicentre d’une quête et d’une enquête amoureuses où le narrateur met à « nu » Marie, où il cherche « sa vérité » et une issue à leur relation amoureuse délétère. Dans le même décor, le narrateur de Nue mène l’enquête rétrospectivement sur les circonstances dans lesquelles Jean-Christophe de G et Marie se sont rencontrés. Le récit de la longue séance d’« espionnage » à laquelle se livre le narrateur, avatar de celui de la Jalousie32(Alain-Robbe-Grillet), relève bien de l’enquête, théâtralisée avec humour autour d’un hublot, métaphore de l’œil et de la pensée : « Accroupi sur le toit, penché sur le hublot, j’essayais de reconnaître Marie dans cette foule lointaine […]. Je ne savais quelle valeur accorder à ce réel ankylosé […] »33.
Depuis son poste d’observation, sur le toit du musée, le narrateur assiste aux manœuvres d’un redoutable Valmont de musée – alias Jean-Christophe de G – pour séduire sa proie, Marie, en réalité indomptable. L’enquête amoureuse se prolonge incidemment dans une introspection qui révèle au narrateur son « musée imaginaire ». Moins conservatoire d’œuvres que musée personnel, « sentimental », le musée est dans ces cas de figure, un lieu au sein duquel le narrateur collecte, conserve et analyse des souvenirs, des sensations et des images, associant étroitement musée et remémoration.
Au musée, passé, présent et futur s’entrecroisent en effet, comme dans ce passage révélateur :
C’est quand on se promène dans le temps, et qu’on a la sensation d’être à la fois dans le présent et dans le passé […] que l’esprit peine à ajuster ses repères, parce que le temps, alors, n’est plus perçu comme la succession d’instants qu’il a toujours été, mais comme une superposition de présents simultanés34.
Ainsi, le musée est un espace propice aux analepses et aux prolepses grâce auxquelles le narrateur revoit les derniers jours de sa relation avec Marie, les débuts de la relation de J.-C. de G avec elle, conformément à une esthétique temporelle et processuelle du making-of. Ce feuilletage temporel suggère que le roman e(s)t le musée, le décor où l’amour est conservé comme une précieuse relique, mais aussi le tombeau (au sens littéraire du terme aussi) où le narrateur se souvient et fait le deuil de cet amour perdu, qui se fait et dé-fait sans cesse.
Aussi les making-of personnels, amoureux, doublent-ils les making-of artistiques où le narrateur présente les coulisses du monde de l’art et des musées, quand l’artiste s’approprie l’espace muséographique : « Elle [Marie] avait détaché une petite feuille de son agenda […], elle traçait des croquis, un plan sommaire de l’espace […] »35. De même, au moment du montage d’une exposition :
[L]a présentation de la robe en miel au Spiral de Tokyo avait nécessité des mois de travail et la mise en place d’une petite cellule spécialisée qui s’était consacrée exclusivement au développement du projet de la robe en miel36.
… ou au cours de mondanités avec les hôtes nippons de Marie quand celle-ci s’apprête à présenter sa robe37, parallèlement à des passages similaires que retrace la quête d’un espace de tournage dans Made in China, au Times Museum de Canton :
Il m’importait moins de mener à bien, selon des critères connus et définis au préalable, un film idéal […] que de rester disponible et de me mettre en adéquation avec la situation que j’allais trouver38.
Or, précisément, les coulisses du musée sont observées depuis le toit du musée, la salle de contrôle où s’alignent les écrans de surveillance disposés dans les salles d’exposition. De ce point de vue, les musées concernés s’apparentent au « cube blanc » de l’art contemporain, espace vierge et modulable que la main et le regard de l’artiste, la pensée et l’écriture de l’écrivain investissent à la manière d’une page blanche où s’expose et s’analyse le processus créatif, comme le narrateur de Made in China le souligne au sujet des murs blancs d’un studio de tournage39. Ce sont là aussi des espaces protégés et « retiré[s] »40, en dehors du temps, où les narrateurs, à la « misanthropie » plus ou moins « tempérée »41, aiment à se retirer, comme Henri de Montalte, le père de Marie, dans sa maison, musée d’une vie où sa fille accomplit un pèlerinage (Fuir, Nue, La Vérité sur Marie).
Par conséquent, les musées toussaintiens se distinguent par la découverte que fait le narrateur d’un poste d’observation depuis lequel il pourra examiner au mieux l’objet de sa quête/de son enquête. Le narrateur expérimente alors plusieurs manières de voir en se laissant porter au hasard de ses pas et de ses impressions rétiniennes. Dans La Télévision, le traditionnel banc de musée (dans la salle des États du Louvre, à Paris, dans celle des Dürer, à Berlin) cède la place au poste de contrôle des gardiens et aux moniteurs de surveillance :
[I]l n’était pas rare que, à peine entré dans un musée, j’aille aussitôt m’asseoir sur une banquette. Assis devant quelque tableau, je restais là des heures à méditer paisiblement à mon étude, généralement seul, à peine troublé par le manège feutré des gardiens […]. [J]écrivais quelques mots en toute quiétude comme dans la plus tranquille des bibliothèques ou comme à la piscine42.
Dans cette pièce, le narrateur adopte plusieurs points de vue grâce aux différentes caméras disposées dans les salles : cette chorégraphie des points de vue prépare le moment où le narrateur voit le portrait de Charles Quint par Amberger sous un nouveau jour, grâce à l’écran qui fera apparaître son propre visage par un jeu de lumière et de contraste particulier sur fond blanc et noir :
Je rouvris les yeux, et, lorsque je posai de nouveau le regard sur l’écran du moniteur, c’est mon propre visage que je vis apparaître en reflet sur l’écran, qui se mit à surgir lentement des limbes électroniques des profondeurs du moniteur43.
Dans Faire l’amour, le narrateur cherche Marie dans les salles du musée avant de la trouver depuis le poste de contrôle du musée, dans un jeu de cache-cache en clair-obscur qui s’achève dans Nue sur les toits de l’institution tokyoïte, cube blanc illuminé, plongé dans l’obscurité de la nuit :
Je regardais fixement cette rangée d’écrans blancs qui scintillaient légèrement, quand je vis soudain Marie apparaître dans le tableau, silhouette solitaire que je voyais se mouvoir lentement devant moi sur l’écran. Elle passait comme en apesanteur d’un écran à l’autre, manteau noir sur fond blanc, disparaissant de l’un et surgissant de l’autre […]. [C]’était étrange et même un peu douloureux […]44.
Le narrateur ne cesse ainsi de prendre du recul, du champ notamment parce que le musée surimpose cadres et écrans (de tableaux, d’écrans, de fenêtres) à son propre regard dans une mise en abyme vertigineuse. Ses yeux sont également mis à rude épreuve par les lumières contrastées qui lui imposent une accommodation permanente, le plongeant tantôt dans l’obscurité, l’assaillant tantôt d’un halo de lumière aveuglant d’où jaillissent autant de vérités, ici le visage de Marie, là son propre visage :
Je quittai la salle de contrôle et entrai dans les salles d’exposition, le flacon à la main. J’avançais [...] lentement dans les ténèbres des salles entre les œuvres de Marie […], des photos de très grand format […]. [J]e voyais des ombres et des profils immobiles dans des attitudes de défiance […]. Mes yeux brillaient d’un éclat de vif-argent, et je les écarquillais pour percer l’obscurité […]45.
Les personnages font l’expérience ontologique de la révélation à soi et à la Mort que Roland Barthes associe étroitement à la photographie : « Car la Photographie, c’est l’avènement de moi-même comme autre une dissociation retorse de la conscience d’identité »46. Et de préciser : « [L]orsque je me découvre sur le produit de cette opération, ce que je vois, c’est que je suis devenu Tout-Image, c’est-à-dire la Mort en personne ; les autres l’Autre me déproprient de moi-même […] »47. Ces dépropriations de soi s’accompagnent d’une expérience suspendue du temps propre à la révélation.
Ces jeux de clair-obscur et de focale associent le musée à un espace de révélation lié au « lent » procédé chimique caractéristique de la photographie que traduit l’isotopie du regard, de la vue et du point de vue dans les textes. Dans cette perspective, Franck Wagner écrit :
Tous ces textes proposent en fait le récit, partial et partiel, du rapport au monde d’une conscience individuelle, dont l’inévitable subjectivisme est pleinement assumé, jusqu’en ses conséquences relativistes […]48.
L’analyse proposée par Olivier Mignon souligne ainsi avec justesse la manière dont cette conscience individuelle s’exprime et se révèle à elle-même tout au long du lent processus qui conduit au déclenchement soudain de la prise de vue :
Ainsi s’éclaire la valeur paradoxale que Toussaint accorde à la photographie : l’événement dont elle témoigne, c’est moins l’objet mis devant la lentille que l’ensemble des circonstances qui ont précédé le déclenchement. […] Sans nul doute, l’auteur pourrait faire sienne la phrase de Denis Roche : « ce qu’on photographie, c’est le fait qu’on prend une photo »49.
Long processus car le narrateur, indéfectible rêveur, trouve ce qu’il ne cherchait pas après un moment d’égarement auquel succède un moment fulgurant de lucidité et de clairvoyance. L’emploi du verbe « tomber », dans l’extrait relatant la découverte, à la Bibliothèque publique d’information, de la nouvelle de Musset concernant une rencontre riche de sens entre Titien et Charles Quint, est révélateur de ce point de vue : « Devant les œuvres de Musset, que j’avais fini par trouver dans l’allée consacrée à la littérature française,[…] je tombai sur le texte que je cherchais, une nouvelle de Musset appelée le Fils du Titien »50.
Quant à la solution technique et esthétique que cherche le narrateur de Made in China pour l’armature de la robe de miel dont le personnage Marie a conçu le projet, c’est aussi au hasard d’une déambulation dans un musée qu’il la trouve :
Je m’étais rendu un matin au Victoria & Albert Museum et, dans une salle consacrée aux années 1850-1870 (Fashion and Industry), je m’étais arrêté pour lire avec intérêt un cartel qui évoquait le développement de l’acier à ressort. Poursuivant ma visite, j’étais alors tombé en arrêt sur ce que je n’arrivais ni à définir ni à nommer […] une crinoline51.
La métaphore de la révélation photographique, tout en noir et blanc, constitue dès lors un leitmotiv prégnant dans les deux romans de musée que sont Faire l’amour et La Télévision. Ici et là, la scène épiphanique s’opère dans l’espace métaphorique de la salle de contrôle du musée, dans les coulisses du musée, où sont alignés des moniteurs de surveillance dont les écrans sont tantôt blancs, tantôt noirs.
Dans le premier roman, deux scènes sont remarquables de ce point de vue : d’abord, celle où le narrateur découvre en « pass[ant] une tête52 », l’air de rien, comme par hasard donc, les « parfaits monochromes hypnotiques53 » que constituent les écrans, dans une confusion significative entre peintures et moniteurs. De fait, Marie ne tarde pas apparaître sur plusieurs écrans, au gré de ses déplacements dans le musée. Un portrait cinétique se dessine par intermittence : « Elle passait comme en apesanteur d’un écran à l’autre, manteau noir sur fond blanc, disparaissant de l’un et surgissant de l’autre […]. [C]’était étrange et même un peu douloureux […] »54.
Ce jeu de cache-cache douloureux préfigure la rupture des deux amants qu’annonçait la description de la « focale en plongée où les personnages que l’on découvre à l’image apparaissent souvent comme des victimes désignées ou des morts en puissance55. » Puis Marie fixe un écran, croisant sans le savoir le regard du narrateur : sur le moment, celui-ci pense que tout est fini entre eux dans un moment d’une grande intensité dramatique.
La seconde scène, dans une construction en diptyque, traite du retour du narrateur au musée dans la salle de contrôle, mais les écrans sont désormais noirs. Il quitte alors cette chambre noire pour l’espace d’exposition dont les cimaises blanches sont justement couvertes de photographies de Marie et d’œuvres aux airs monstrueux et fantomatiques56, comme les statues antiques du Louvre, dans Fuir.
Dans La Télévision, une scène similaire a lieu au musée de Dahlem, vaste galerie de peintures à Berlin. Alors que le narrateur vient de quitter son tête-à-tête avec les toiles de la salle des Dürer, assis dans un « doux clair-obscur de bibliothèque ensoleillée »57 autrement qualifié de « petit cabinet privé isolé »58, il parvient, sans le vouloir, à la salle de contrôle du musée, où les moniteurs captent des images en noir et blanc. Le narrateur aperçoit le portrait de Charles Quint par Amberger mais il le distingue mal. Il ferme alors les yeux pour retrouver dans sa mémoire, fontaine de Jouvence, les traits de l’adolescent fixés par l’artiste et quand il rouvre les yeux, apparaît, comme au terme d’un processus magique digne de la chimie photographique, son propre portrait qu’une description, faite par ses soins dans son bureau, avait amorcée au début du roman mais, par comparaison, avec le vieil empereur usé. La métaphore photographique, qui donne sa raison d’être au roman L’Appareil-photo (1989), fonctionne à plein, aussi bien dans l’évocation de la révélation photographique de l’image, que dans celle du cadre où elle opère : en marge des espaces d’ « exposition » (dans tous les sens du terme), en marge des espaces publics et éclairés, des espaces dévolus au visiteur lambda, dans des « chambres noires » où le regard du narrateur s’accommode comme nulle part ailleurs, où les secrets enfouis des êtres (de Marie, de leur amour, les siens) s’imposent à lui comme surgissant de profondeurs insoupçonnées. Il est ainsi significatif que le narrateur de La Télévision voit dans les images projetées par les écrans « des plans fixes de parking souterrain »59. Car il s’agit de fouiller les souterrains de sa mémoire, de descendre en soi.
Fuir décline cette image autour d’un autre motif : la mort de son père que Marie apprend au Louvre et que le narrateur rapporte dans une paralepse60. Or, Marie indique aussitôt au narrateur, joint par téléphone, qu’il « fait jour », qu’« il fait terriblement jour »61. Le décalage horaire qui la sépare de lui, en voyage en Chine (il est plongé dans la nuit, elle évolue en plein jour, à Paris), ne suffit pas à expliquer cette remarque. Dans un entretien, l’auteur a précisé que le téléphone portable a rendu possible l’ubiquité de la scène et l’échange entre les deux personnages, l’un plongé dans la nuit la plus profonde que fend le train, éclairé, tel un néon, et l’autre surexposé en plein jour62. À cet égard, Toussaint s’inscrit dans des représentations et dans une réception des collections du Louvre qu’il renouvelle au prisme d’effets narratifs et esthétiques contemporains63.
Marie veut fuir la lumière pour commencer son deuil, pour se recueillir. Elle cherche aussi à fuir la foule, le bruit et les œuvres du musée qui font obstacle à son cheminement vers les ténèbres qui ont trop soudainement happé son père. De ce point de vue, la course de Marie s’apparente à une catabase64 : ne pourrait-on pas voir dans ce passage spectaculaire, au sens propre du terme, qui a pour décor le palais trop lumineux, « inond[é] de lumière »65, du Roi-Soleil et les salles de sculptures antiques66, la réécriture vaine et l’inversion du mythe de Déméter allant chercher sa fille Perséphone aux enfers, la fille son père en l’occurrence ? La thématique de la lumière convoque d’ailleurs un riche intertexte mythique autour des figures d’Apollon, de Phèdre (fille du Soleil) et d’Icare qui ajoute à la dimension classique et monumentale, écrasante, du palais des rois de France. Les sculptures ont justement des airs épouvantables de monstres infernaux figurant le cauchemar intérieur que traverse Marie métaphoriquement, avant qu’elle ne débouche dans une salle voûtée dont le plafond figure un ciel parcouru de nuages, qui masquent le soleil donc, salle où elle s’apaise un moment67. Son parcours dans le musée n’est pas achevé pour autant : Marie traverse des pièces, des couloirs, monte et descend des escaliers dans le musée, puis à ses abords, jusqu’à la scène finale où elle se trouve confrontée à une victime d’un accident de la route. Aveuglée par le jour et par la mort qui se rappelle à elle sans cesse, Marie tente une dernière manœuvre pour échapper à la révélation, fuir la réalité : elle interpose un écran entre elle et la réalité, ses lunettes de soleil, rejoignant ainsi la nuit dans laquelle se trouve plongé le narrateur, à des milliers de kilomètres.
Comme en témoigne l’isotopie de la lumière dans toute l’œuvre, le musée est un espace où l’on voit (trop) clair, où l’on risque de se brûler les yeux. Sans doute est-ce la raison pour laquelle le narrateur de Faire l’amour débouche son flacon d’acide chlorhydrique, dans un geste compensatoire, aux abords du musée d’art contemporain où il a eu la révélation de la fin de son histoire d’amour68. Isabelle Ost affirme ainsi que :
[c]e qui constituerait l’idéal de la photographie pour le narrateur, [ce serait] une image unique et impossible, image paradoxale du mouvement-immobilité, de l’absence-présence, du plein et du vide, du sujet en apparition et disparition simultanées – image refoulée qu’il faut sortir de soi dans un geste de délivrance69.
Les musées prennent tous des airs de laboratoire photographique où sensations et pensées, sentiments et souvenirs se révèlent au narrateur pour nourrir sa réflexion, pour alimenter l’écriture romanesque. Cette métaphore ne culmine-t-elle pas dans l’image de la tête même de l’auteur aussi que Toussaint fait scanner, radiographier et exposer de façon spectaculaire dans l’exposition Livre-Louvre, en 2012 ? En dernier ressort, le musée ne serait-il donc pas l’image de la tête, du « musée mental » où Toussaint, non sans auto-dérision, collecte, range, analyse et expose tout ce qui compose son psychisme, sa vie intérieure, les synesthésies, les références artistiques et visuelles, les œuvres d’art, lunettes ou écrans avec lesquels il voit et décrypte le monde ? À cet égard, Olivier Mignon souligne l’importance du motif de la cabine, de l’espace clos qu’il lie étroitement à la réflexion et à la pratique photographique dans les romans de l’écrivain :
La métaphore de la chambre noire nécessaire à l’imprégnation d’une image n’a ici rien d’excessif, si l’on en juge par la récurrence du motif d’un personnage installé dans un espace confiné, obscur et silencieux, les yeux souvent clos, tâchant de fixer un événement, une pensée, une parole […]70.
En ce sens, le musée fonctionnerait de la même manière que le site kaléidoscopique de l’écrivain qu’il nourrit méticuleusement de l’ensemble de ses archives et des informations touchant à son œuvre : le « BORGES projet »71 en est à l’image avec sa constellation mouvante de nouvelles.

Figure 2 : Autoportrait Jean-Philippe Toussaint, Autoportrait en lecteur, image 15 x 15 cm, obtenue par résonance magnétique, retouchée et tirée sur papier, Fine Art Etch 300 grammes, 2012.
De fait, le musée se métamorphose et s’insinue partout dans l’œuvre de Toussaint72. Dans La Télévision, l’historien de l’art n’a d’ailleurs pas besoin de se trouver au musée pour voir une œuvre (le tableau d’Amberger) dans son visage et réciproquement. Comme Swann pour qui Odette a des airs de muse renaissante de Botticelli, le narrateur voit des tableaux, des cadres et des œuvres partout, à l’instar du narrateur de Nue qui associe les deux moments où lui a été révélée la grossesse de Marie, d’abord intuitivement, ensuite directement, à deux icones, deux « Annonciations », l’une de Hopper, l’autre de Botticelli justement :
Et je songeai alors que ces deux scènes s’apparentaient en réalité à des Annonciations, la première à Saint-Sulpice, une Annonciation contemporaine, […] une photo à la Nan Goldin […] qui rappelait le fameux tableau de Hoper (Nighthawks) […]. La scène à Portoferraio, celle des Annonciations italiennes de la Renaissance […], cette Vierge de Botticelli […]73.
Dès lors, les musées de Toussaint s’apparentent à la petite commode74 qui désigne, sur le site Web officiel de l’auteur (comparé à un scriptorium par Laurent Demoulin)75, ses « cahiers d’archives », sa mémoire littéraire, les différentes versions de ses œuvres, comme autant de strates souterraines que le site fait apparaître à la surface de l’écran, révèle au regard de l’internaute dont le visage et la silhouette se reflètent dans le texte dévoilé sur son propre écran…
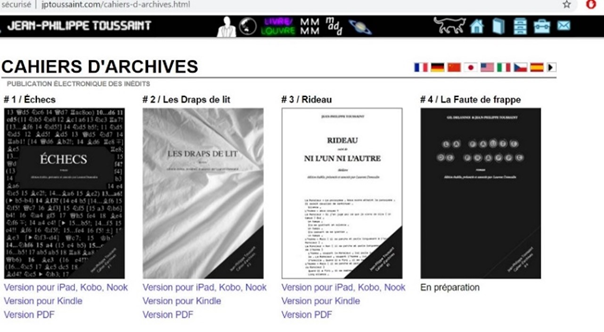
Figure 3 : Capture d’écran du site officiel
de l’auteur, « Cahiers d’archives »
site officiel de l’auteur : http://www.jptoussaint.com/cahiers-d-archives.html, © Jean-Philippe Toussaint
Musée, cerveau, commode sont autant de motifs qui parsèment les romans de Toussaint : voilà révélés les secrets du titre baudelairien donné à cet article en référence au poème intitulé « J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans », extrait du recueil des Fleurs du mal (1857). Ce sont là les motifs saillants de la réflexion de Toussaint sur le musée, et tant d’autres : du « cerveau » au « caveau » du cimetière de l’île d’Elbe, en passant par la « pyramide » du Louvre jusqu’au flacon de Faire l’amour :
Un gros meuble à tiroirs
encombré de bilans,
De vers, de billets doux, de procès, de romances,
Avec de lourds cheveux roulés dans des quittances,
Cache moins de secrets que mon triste cerveau.
C’est une pyramide, un immense caveau,
Qui contient plus de morts que la fosse commune.
– Je suis un cimetière abhorré de la lune,
Où comme des remords se traînent de longs vers
Qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers.
Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées,
Où gît tout un fouillis de modes surannées,
Où les pastels plaintifs et les pâles Boucher,
Seuls, respirent l’odeur d’un flacon débouché.
[…]76
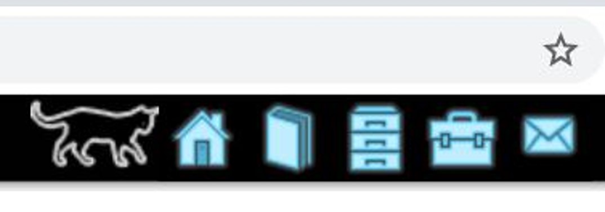
Figure 4 : Capture d’écran figurant un
détail du menu,
site officiel de l’auteur : http://www.jptoussaint.com/cahiers-d-archives.html, © Jean-Philippe Toussaint
Chambre noire, instrument d’optique, commode, le musée toussaintien est un « lieu autre », une hétérotopie pour reprendre la notion développée par Michel Foucault dans une conférence de 1967 intitulée « Des espaces autres »77. Par ce terme, le philosophe désigne des lieux imaginaires et réels, textuels et architecturaux, localisés et matérialisés dans l’espace social, qui génèrent des histoires.
L’image de la tête-musée, qui est apparue comme une clef de lecture autour de l’exposition du Louvre, conduit de fait à repérer des rapprochements avec d’autres lieux, mais aussi avec d’autres activités pratiquées par le narrateur : la marche et la natation.
À plusieurs reprises en effet, la manière dont la pensée du narrateur se déploie comme un flux qui remonte à la surface pour imprimer sa rétine et lui révéler une vérité, fait penser au bain de tirage à partir duquel émerge l’image photographique. Or, précisément, ce procédé chimico-aquatique fait écho à d’autres bains révélateurs qui scandent l’œuvre romanesque : pensons à ces bains moins récréatifs que créateurs au cours desquels le narrateur de Toussaint fait l’expérience d’une harmonie totale entre les mouvements de son corps et sa pensée, de la fluidité même de sa pensée. Est-ce un hasard si le narrateur désigne par le terme de « hublot » la fenêtre du toit du musée dans Nue78, ou s’il parcourt la chaufferie du musée de Dahlem, pareil au sas de décompression d’un sous-marin, avant et après deux moments d’introspection ?
La pièce était dans la pénombre, les murs et le plafond entièrement recouverts de tuyaux de différentes tailles […]. Divers extincteurs étaient fixés sur les murs avec du matériel […] hétéroclite […], bombonnes et masques à oxygène […]79.
Dès lors, le bain du narrateur de Faire l’amour sur le toit de son hôtel à Tokyo80 et les bains berlinois du narrateur de La Télévision dans un lac et dans une piscine, peuvent être rapprochés des moments où il arpente les musées, mais aussi des moments de repos où, assis sur un banc dans la salle des Dürer, le narrateur ressent le sac et le ressac de sa pensée dans sa tête, motif prégnant dans L’Urgence et la patience pour décrire la création et la pensée : « Il faut plonger, très profond, prendre de l’air et descendre, abandonner le monde quotidien derrière soi et descendre dans le livre en cours, comme au fond d’un océan »81.
Le regard du visiteur au musée, pour être contemplatif, réflexif, concentré, mélancolique n’en est donc pas moins actif, créatif, sportif, voire athlétique : le narrateur est tour à tour un marcheur-baigneur-assis. Les moments d’intense activité cérébrale trouvent en effet leur pendant dans les scènes de baignade qui les précèdent ou qui les suivent. Un esprit sain dans un corps sain. L’urgence et la patience. L’air de rien, l’historien de l’art écrit son livre dans La Télévision, qu’il fixe ou pas le flux de sa pensée sur ses petits carnets, qu’il contemple un tableau sur un banc de musée, un écran de contrôle ou qu’il nage. La scène où Marie couvre de notes ses propres carnets au Hara Museum traduit aussi le rapport créatif de l’artiste, bien qu’immobile et silencieuse, à l’espace muséographique : artiste et « femme d’affaires »82, elle prend possession de l’espace d’exposition (Faire l’amour83, Nue84).
Dans l’œuvre romanesque de Toussaint, le musée est figuré comme un lieu d’observation où la pensée se révèle à elle-même. Tels l’appareil-photo ou la télévision, il opère comme un dispositif technique, un instrument d’optique qui fait voir la pensée et la révèle à elle-même85. Le musée est aussi un lieu de vie pour Toussaint : c’est sans doute la raison pour laquelle le narrateur prend tant ses aises en ses murs, pourquoi il quitte les sentiers battus et les salles silencieuses pour les espaces masqués aux yeux du visiteur type. C’est sans doute aussi pourquoi il s’attache à représenter les musées avec beaucoup d’humour – d’amour – et dans une position décalée, hors-champ : depuis les coulisses (sur le toit, dans les couloirs, depuis une salle de contrôle), avant une exposition, pendant un vernissage, dans des salles retirées. Autour d’installations et de dispositifs inouïs qui créent des chocs artistiques et intellectuels par la confrontation de supports, de références, de cultures, ce dont Marie et Toussaint ont le secret : la robe de miel de Nue et de Made in China, la cabine de douche et les tablettes numériques, les néons flashy et l’embrasement de L’Enfer de Dante dans le « musée des musées », le Louvre.
Cette façon d’envisager le musée rejaillit sur une conception particulière de l’œuvre toussaintienne qui ressort grâce au contraste établi avec certaines représentations, œuvres ou espaces immobiles, figés, stéréotypés. Ainsi, chez Toussaint, le sens de l’œuvre n’est pas présenté comme clos sur lui-même, ce dont l’historien de l’art fait l’expérience dans La Télévision, mais aussi le lecteur et l’internaute qui consulteraient le site Web de l’écrivain. Corrélativement, l’œuvre n’est jamais achevée, ni même maîtrisée par l’artiste comme en témoigne le happening des abeilles de la robe de miel dans Nue. L’œuvre n’est donc pas sacrée, pas plus que le musée. Dans certains musées de Toussaint, il est parfois possible de toucher les œuvres justement, un sandwich dans la poche de sa veste, et le visiteur peut interagir avec elles, comme le suggère le dispositif de la salle de bain dans l’exposition du Louvre. Moins conservatoires que laboratoires, moins sanctuaires que chambres noires, les musées de Toussaint sont des lieux de vie et de création comme les « bureaux » de l’écrivain que l’auteur nous dévoile justement dans des termes voisins86. Dans ces lieux, l’art est vivant. Ce sont des lieux qui révèlent la pensée et le corps à eux-mêmes dans une expérience synesthétique complète, des lieux, enfin, où l’art et l’écriture s’exposent en train de se faire, de se défaire. Le narrateur de Made in China ne dit pas autre chose à cet égard : « Il suffit de se mettre à écrire pour se rendre compte que le monde entier est en travaux. Partout, on bâtit, on détruit, on rénove »87.
[1] Voir récemment Maxime THIRY sur le musée toussaintien comme espace de méditation : « ‘Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour une exposition !’ : réciprocité du livre et du musée dans l’œuvre de Jean-Philippe Toussaint », colloque international « Le musée dans la littérature », 7-9 novembre 2019, coord. Caroline MARIE, Anne CHASSAGNOL, Christine BERTHIN et Charlotte ESTRADE, université Paris 8-St Denis et université Paris-Nanterre, 7-9 novembre 2019.
[2] Jean-Philippe TOUSSAINT, La Salle de bain, Paris, Éditions de Minuit, 2005, p. 42.
[3] Id., La Réticence, Paris, Éditions de Minuit, 1991, p. 15.
[4] Id., Faire l’amour, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Double », 2002.
[5] Les derniers romans de l’auteur sont exclus de l’étude car ils ne traitent pas de musées. Toutefois, la thématique architecturale, très prégnante dans ces textes, entretient un lien étroit avec les musées des romans antérieurs dont les architectures occupent une place centrale.
[6] Philippe ORTEL, La Littérature à l’ère de la photographie : enquête sur une révolution invisible, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 2002, p. 11.
[7] Philippe HAMON, Imageries, littérature et image au xixe siècle, Paris, Éditions José Corti, 2001.
[8] Isabelle OST, « Dispositifs techniques et place du sujet dans quelques romans de Jean-Philippe Toussaint », Textyles n°38, 2010, http://journals.openedition.org/textyles/306 (page consultée le 20 octobre) et Arcana ALBRIGHT, « Jean-Philippe Toussaint : la littérature à l’âge des écrans », in Jean-Michel DEVESA (dir.), Lire, voir, penser l’œuvre de Jean-Philippe Toussaint, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2020, p. 237-245.
[9] J.-P. TOUSSAINT, L’Urgence et la patience, Paris, Éditions de Minuit, 2012, p. 47 et suiv.
[10] Id., La Télévision, Paris, Éditions de Minuit [1997], coll. « Double », 2004.
[11] François PONCELET, « Regards actuels sur la muséographie d’entre-deux-guerres », CeROArt, n°2, 2008, § 5, http://ceroart.revues.org/565 (page consultée le 23 octobre).
[12] J.-P. TOUSSAINT, Faire l’amour, p. 103-104.
[13] Id., Nue, Paris, Éditions de Minuit, 2013, coll. « Double », 2017, p. 47.
[14] Ibid., p. 48.
[15] Ibid., p. 51.
[16] Ibid., p. 48. Voir l’extrait cité dans Serge CHAUMIER et Isabelle ROUSSEL-GILLET, Le Goût des musées, Paris, Mercure de France, coll. « Le petit Mercure ».
[17] Ibid., p. 47 et suiv.
[18] Ibid., p. 72.
[19] Loc. cit.
[20] Loc. cit.
[21] J.-P. TOUSSAINT, La Télévision, p. 192.
[22] Ibid., p. 189-190.
[23] Olivier MIGNON, « Presque sans lumière. Du statut des images dans les écrits de Jean-Philippe Toussaint », Textyles, n°38, 2010, http://journals.openedition.org/textyles/296, § 8 et suiv. (page consultée le 26 octobre 2020).
[24] J.-P. TOUSSAINT, Fuir, Paris, Éditions de Minuit, 2005, coll. « Double », 2013, p. 45.
[25] Id., La Télévision, p. 185. Il s’agit de pièces tirées des collections précolombiennes ethnologiques.
[26] Id., [cat. exp. Livre/Louvre, 7 mars-11 juin 2012, Musée du Louvre] La Main et le regard, Paris, Le Passage et Louvre éditions, 2012, p. 24.
[27] Id., La Télévision, p. 188.
[28] Par exemple : « Assis devant quelque tableau, je restais là [au musée de Dahlem] des heures à méditer paisiblement à mon étude » : ibid., p. 183-184.
[29] Ibid., p. 64-65.
[30] Id., Nue, p. 36.
[31] Id., Faire l’amour, p. 46.
[32] Voir le mémoire de Carole BENFANTE, Jean-Philippe Toussaint, nouveau « nouveau romancier » ? Université de Liège, 2009, p. 23 et suivantes
[33] J.-P. TOUSSAINT, Nue, p. 58-60.
[34] Ibid.
[35] Id., Faire l’amour, p. 100-101.
[36] Id., Nue, p. 13.
[37] Id., Faire l’amour, p. 88 et suiv.
[38] Id., Made in China, Paris, Éditions de Minuit, 2017, p. 23.
[39] Ibid., p. 83.
[40] Id., Fuir, p. 126.
[41] Loc. cit.
[42] Id., La Télévision, p. 184.
[43] Ibid., p. 197.
[44] Id., Faire l’amour, p. 103.
[45] Ibid., p. 143-144.
[46] Roland BARTHES, La Chambre claire, Paris, éditions L’Étoile, Gallimard, Le Seuil, coll. « Cahiers du cinéma », 1980, p. 28.
[47] Ibid., p. 31.
[48] Frank WAGNER, « Monsieur Jean-Philippe Toussaint et la notion de Vérité », Textyles, n°38, 2010, https://journals.openedition.org/textyles/202, § 13 (page consultée le 30 octobre).
[49] O. MIGNON, « Presque sans lumière », ibid., § 18 : Denis ROCHE, La Disparition des lucioles. Réflexions sur l’acte photographique, Paris, Éditions de l’Étoile, 1982, p. 73.
[50] J.-P. TOUSSAINT, La Télévision, p. 73.
[51] Id., Made in China, p. 111.
[52] Id., Faire l’amour, p. 102.
[53] Ibid., p. 103.
[54] Ibid., p. 103-104.
[55] Loc. cit.
[56] Ibid., p. 144.
[57] Id., La Télévision, p. 187.
[58] Loc. cit.
[59] Id., La Télévision, p. 195.
[60] Gérard GENETTE, Figures III, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1972, p. 211, 213, 221-222.
[61] J.-P. TOUSSAINT, Fuir, p. 43.
[62] Dans un entretien (« Écrire, c’est fuir », conversation à Canton entre Chen Tong et Jean-Philippe Toussaint les 30 et 31 mars 2009, p. 179), paru à la suite de Fuir, et lors du colloque arrageois, l’auteur a rappelé qu’il a été tenté un temps de situer la scène au Centre Pompidou mais que le poids symbolique du musée du Louvre et de ses salles d’apparat, dorées, lumineuses, l’ont décidé à se fier à son intuition première.
[63] Guy DUCREY, « Le Louvre des objets fantastiques. À propos de Jean Fanfare de Paul d’Ivoi (1897) », p. 567-577 ou encore Sophie BASCH, « La postérité littéraire et artistique de la Victoire de Samothrace : petite anthologie », p. 615-627, dans Jessica DESCLAUX (dir.), « Le musée du Louvre et les écrivains entre deux siècles (1874-1926) », Revue d’histoire littéraire de la France, Paris, Classiques Garnier, n°3, 2019.
[64] Sylvie LOIGNON, « Comment finir ? La mélancolie de Jean-Philippe Toussaint », Textyles, n°38, 2010, http://journals.openedition.org/textyles/308, § 18 (page consultée le 21 octobre).
[65] J.-P. TOUSSAINT, Fuir, p. 45.
[66] Ibid., « Écrire, c’est fuir », p. 179-180.
[67] Id., Fuir, p. 46.
[68] Id., Faire l’amour, p. 144-146.
[69] I. OST, « Dispositifs techniques et place du sujet dans quelques romans de Jean-Philippe Toussaint », op. cit., § 9.
[70] O. MIGNON, « Presque sans lumière », op. cit., § 19.
[71] http://www.jptoussaint.com/borges-projet-appel.html (page consultée le 27 janvier 2020).
[72] Du reste, dans Monsieur, le narrateur visite le Palais de la Découverte, musée scientifique. In Jean-Philippe TOUSSAINT, Monsieur, Paris, Éditions de Minuit, 1986, p. 72.
[73] J.-P. TOUSSAINT, Nue, p. 156-158.
[74] http://www.jptoussaint.com/cahiers-d-archives.html (page consultée le 16 février 2020).
[75] Laurent DEMOULIN, « Dans le scriptorium de Jean-Philippe Toussaint », Textyles, n°38, 2010, http://journals.openedition.org/textyles/322 (page consultée le 25 octobre 2020).
[76] Charles BAUDELAIRE, « J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans », Les Fleurs du mal, LXXVI, « Spleen », 1857.
[77] Voir, pour la version publiée : Michel FOUCAULT, Le corps utopique suivi de Les hétérotopies, Paris, Éditions, Lignes, 2009.
[78] J.-P. TOUSSAINT, Nue, p. 56-58. L’auteur a rapporté lors du colloque arrageois que le choix du hublot tient aux conseils d’un architecte qui lui indiquait le caractère contemporain de ce type d’ouverture en matière architecturale pour correspondre à la silhouette du musée représenté dans le roman.
[79] Id., La Télévision, p. 194.
[80] Id., Faire l’amour, p. 38 et suiv.
[81] Id., L’Urgence et la patience, p. 41.
[82] Id., Nue, p. 37.
[83] Id., Faire l’amour, p. 100 et suiv.
[85] I. OST, « Dispositifs techniques et place du sujet dans quelques romans de Jean-Philippe Toussaint », art. cité, § 9.
[86] J.-P. TOUSSAINT, « Mes bureaux », L’Urgence et la patience., p. 15 et suiv., et Mes bureaux, luoghi dove scrivo, Venise, Amos Edizioni, 2005.
[87] Id., Made in China, p. 73.
Résumé
L’article étudie les représentations des musées dans l’œuvre romanesque de Toussaint, tour à tour critiqués et recherchés. Si les musées d’art sont ces espaces où s’exposent des œuvres, ils sont surtout le lieu métonymique où l’art de Marie, de Jean-Philippe, où l’écriture s’exposent en train de s’élaborer, où se révèlent à elles-mêmes la pensée et l’identité du narrateur et de l’auteur au sens photographique et épiphanique du terme.
Abstract
The paper analyses the way museums are represented in Toussaint’s novels. It shows that museums magnetize them and are alternately sought and critized. If museums of (contemporary) art are the place where works of art are exhibited, they are also a metonymic place where Marie (character), Jean-Philippe’s art, writing are exhibited in the process of being elaborated, where the thoughts of the narrator and the author reveal themselves in the photographic and epiphanic sense of the term.
Un regard sans complaisance sur les musées réels
Le musée comme espace d’expériences et d’expérimentations hors du commun
Marie-Clémence REGNIER
Université d’Artois, Textes & Cultures UR 4028, TransLittéraires
TOUSSAINT, Jean-Philippe, La Salle de bain, Paris, Éditions de Minuit, [1985], coll. « Double », 2005.
—, La Réticence, Paris, Éditions de Minuit, 1991.
—, La Télévision, Paris, Éditions de Minuit [1997], coll. « Double », 2004.
—, Faire l’amour, Paris, Éditions de Minuit, [2002] coll. « Double », 2009.
—, « Mes bureaux », in L’Urgence et la patience, Paris, Éditions de Minuit, 2012, p. 15-19 et Mes bureaux, luoghi dove scrivo, Venise, Amos Edizioni, 2005.
—, Fuir, Paris, Éditions de Minuit, [2005], coll. « Double », 2013.
—, Livre/Louvre, catalogue de l’exposition, 7 mars-11 juin 2012, Musée du Louvre, La Main et le regard, Paris, Le Passage et Louvre éditions, 2012.
—, Nue, Paris, Éditions de Minuit, [2013], coll. « Double », 2017.
ALBRIGHT, Arcana, « Jean-Philippe Toussaint : la littérature à l’âge des écrans », Jean-Michel DEVESA (dir.), Lire, voir, penser l’œuvre de Jean-Philippe Toussaint, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2020, p. 237-245.
BARTHES, Roland, La Chambre claire, Paris, éditions L’Étoile, Gallimard, Le Seuil, coll. « Cahiers du cinéma », 1980.
FOUCAULT, Michel, Le corps utopique suivi de Les hétérotopies, Paris, Éditions Lignes, 2009.
HAMON, Philippe, Imageries, littérature et image au XIXe siècle, Paris, Éditions José Corti, 2001.
DEMOULIN, Laurent, « Dans le scriptorium de Jean-Philippe Toussaint », Textyles, n°38, 2010, http://journals.openedition.org/textyles/322.
ORTEL, Philippe, La Littérature à l’ère de la photographie : enquête sur une révolution invisible, Nîmes, éditions Jacqueline Chambon, 2002.
OST, Isabelle, « Dispositifs techniques et place du sujet dans quelques romans de Jean-Philippe Toussaint », Textyles n°38, 2010,
http://journals.openedition.org/textyles/306.
MIGNON, Olivier, « Presque sans lumière. Du statut des images dans les écrits de Jean-Philippe Toussaint », Textyles, n°38, 2010,
http://journals.openedition.org/textyles/296.
WAGNER, Frank, « Monsieur Jean-Philippe Toussaint et la notion de Vérité », Textyles, n°38, 2010, https://journals.openedition.org/textyles/202.